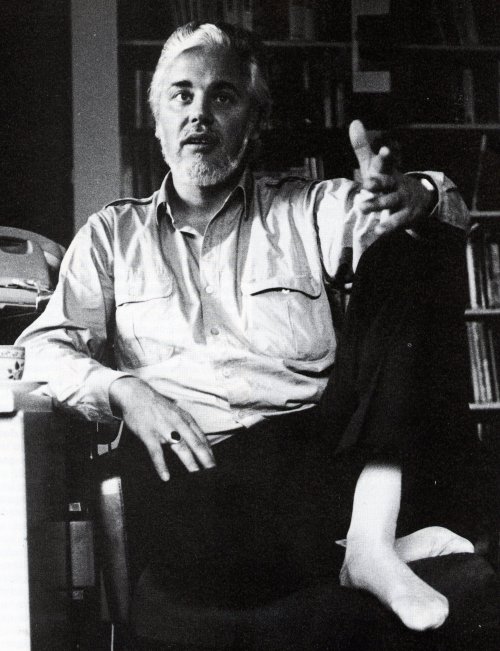
Du temps où les Suisses étaient des Esquimaux.
CET ENTRETIEN NE POUVAIT QUE SE CONTENTER D’EFFLEURER CET OUVRAGE. IL N’EN N’EST NI UN RÉSUMÉ, NI UN SUBSTITUT. SA FONCTION : DONNER ENVIE AUX INDIGÈNES DE SE CONTEMPLER DANS CE MIROIR. LES BONS LIVRES SUR LA CULTURE SUISSE, CEUX QUI N’ABSOLVENT NI NE SE LAMENTENT, SE COMPTENT SUR LES DOIGTS D’UNE MAIN. CELUI-CI EST LE MEILLEUR DE L’APRÈS-GUERRE. ET IL EST TOUT, SAUF MOU !
• Votre livre rectifie bien des erreurs. Un producteur-cinéphile me parlait des deux films suisses ayant fait le plus d’entrées. Votre livre en cite au moins une demi-douzaine d’autres, dont un à un million six cent mille entrées.
Ces chiffres sont généralement ignorés. Je crois que la barrière linguistique y est pour beaucoup puisqu’il s’agit de productions en fait essentiellement zurichoises. Pour Uli, c’est à moitié bernois compte tenu de l’origine du cinéaste. On n’a jamais eu vraiment accès à ces chiffres. Les films eux-mêmes n’ont pas tous été montrés, ici. Le Fusilier Wipf, évidemment, a fait le tour de la Suisse. On sait qu’il a été vu par un Suisse sur trois. Pour Heidi, ce n’est pas un problème vu qu’il a existé une synchronisation française. Mais Heidi nous est parvenu en Suisse romande à travers la distribution de Paris et non pas de Zurich, ce qui explique que de toute manière les information concernant la production elle même ne sont arrivées que fragmentairement.
• N’y a-t-il pas aussi un question de génération ? Qui a vu quoi ?
C’est vrai aussi. En ce qui concerne les muets, ce n’est pas très étonnant puisque sur les quatre vingt-cinq muets réalisés, il n’en existe plus qu’une douzaine. Par ailleurs, il y a eu dans ce livre au départ, une sorte de pari amusé. Je me suis dit qu’en demandant aux gens ce qu’il s’imaginaient sur le cinéma suisse, je recevrais les réponse classiques, à savoir, Goretta Daniel Schmid, Tanner et ainsi de suite. Et puis je leur présenterais ce pavé de trois kilos et demi eu leur disant : « Eh bien voilà ce qu’il y avait avant, un pan entier qui est — presque nonante pour cent, du moins pour la Romandie – inconnu. »
• Goretta n’a pas créé le ciné-club de Genève ?
Le ciné-club, à la fin des années 20, à Genève, était très important. Il a été un des premiers mouvements cinéphiles et pas seulement en Suisse. Les Genevois étaient en contact permanent avec l’avant-garde française, les Germaine Dulac, les Marcel L’Herbier.
• Dans les années 20, il y a à Genève, Willy, René Pellos, Robert Florey, le professeur Rex (C.-E. Sauty). Qu’y font-ils ?
C’est un peu le fruit du hasard que ces gens soient tous ensemble. En ce qui concerne Florey et certainement aussi Pellos, il faut y voir une conséquence de la première guerre mondiale. Florey a passé toute son enfance et toute sa jeunesse dans des ins¬tituts ici, sur les rives du Léman.
• Pellos serait pacifiste, ce qui se retrouverait dans Les Pieds Nickelés !
J’imagine, effectivement. Je n’ai pas étudié la chose plus à fond parce que Pellos ne s’est
jamais occupé directement de cinéma. Mais il faisait partie de la faune qui a osé se jeter à
l’eau, qui a essayé, qui fréquentait les cinéphiles, tous les mordus du cinéma du début des
années 20. C’est une génération très curieuse. Florey m’a écrit plusieurs fois. Il est toujours très touché que l’on évoque cette période et aussi particulièrement chaleureux ! De même, Madame Sauty, à savoir Rexia, la femme du professeur Rex, qui vit toujours, est très émue quand on évoque cet âge héroïque qui semble avoir été particulièrement florissant, plein d’un enthousiasme débordant pour la chose cinéma.
• Florey finit par partir en tenant des propos négatifs.
C’est vrai. Il faut bien le dire : l’enthousiasme pour le cinéma n’était pas nécessairement un
enthousiasme pour le cinéma local. On s’enthousiasmait comme partout pour Douglas
Fairbanks, pour Charlie Chaplin et ainsi de suite. Florey a été simplement conséquent. Il fréquentait un certain Léon Tombet qui avait des moyens, une petite société de distribution de films de publicité. C’est avec lui qu’ils ont tenté le coup. Ils ont essayé de monter une production de films burlesques. Il s’en est fait une série, mais ces films n’ont, vraisemblablement, jamais été distribués de manière conséquente, de manière convenable dans les salles. Ils ont été montrés, même vendus en France, mais on n’en retrouve
pas la trace dans les programmes genevois de l’époque, que j’ai étudiée de très près. Ceci dit,
la publicité de l’époque était ainsi faite qu’on annonçait le grand film et puis pour ce qui
précédait, on disait : divers petits burlesques. Alors, allez deviner de quoi il s’agit.
• J’ai une colle. En 1917, Gabrielle Buffet écrit : « J’ai vu une seule fois un film suisse. Absence totale de virtuosité photographique. Pas de trucs, pas d’effets de luxe ni de toi-lette. Une histoire policière sans intrigue amoureuse, où ne figuraient que des hommes grands, laids, larges d’épaules. Problème posé et se résolvant peu à peu avec une logique si simple que le plaisir de comprendre finissait par l’emporter sur le manque d’attrait visuel choquant au début. » Pouvez-vous situer le film ?
Oui… Cela pourrait être très exactement un film qui a été tourné en 1917, « Le Fluide ». La chose est difficile. En ce qui concerne le cinéma des années 10, je suis pleinement conscient qu’il doit y avoir des lacunes mais des lacunes qui s’expliquent. Je pense avoir épuisé toutes les sources écrites. Or, de toute manière, on écrivait peu sur le cinéma dans les années 10, donc, certainement, il y a eu des choses qui n’ont été mentionnées ni dans la presse courante, ni dans les rares revues corporatives de l’époque. Le problème est le même pour toutes les cinématographies nationales dans la mesure où, pour un chercheur, il n’existe plus du tout — du moins en Suisse – de fichiers de censure. On a pu, par exemple, en ce qui concerne l’Allemagne, reconsti¬tuer une grande partie de la production parce que tous les films passaient par la censure. C’était aussi le cas en Suisse avec une censure cantonale. Les films étaient numérotés, ils avaient une fiche avec le titre, le producteur ou même plus. En Suisse, ces fichiers ont été détruits et la trace-même de ces films s’est perdue.
• La première projection et l’ouverture du premier cinéma ont eu lieu à Genève en 1896. En 1899, la salle ferme. C’est amusant parce que c’est la même chose qu’à Paris
pour les Lumière.
Je crois que c’est un phénomène, sinon mondial, en tout cas euro¬péen. Il y a eu une espèce de curiosité au départ, mais on était loin de se douter de l’impact de cette invention. Louis Lumière a même dit: « c’est une invention sans avenir ». C’est bien grâce aux forains que finalement cette invention, peu à peu, s’est installée et a été exploitée.
• Jusqu’en 1943, un forain suisse allemand fait des projections sous tente.
Oui, oui, bien sûr. Il y a des dynasties de forains suisses. On les retrouve aussi en France, par exemple. Dans le Midi, il y a eu des forains jusqu’à il y a une dizaine d’années. Je ne suis pas sûr d’ailleurs que ce soit tout à fait fini. Si vous prenez le cas de la Cinémathèque de Toulouse, une partie de ses collections a été constituée grâce aux copies qu’on trouvait chez des forains, il y a encore peu de temps.
• Le principe demeure. Il y a encore des inventions récentes dans les baraques de foire.
Oui. Vous avez des super-cinéramas et des inventions diverses.
• Le premier film suisse, aujourd’hui totalement oublié, est dû à Albert Samuel Roth-Markus.
•
C’est bien ça, oui.
• Le deuxième film suisse est un Guillaume Tell d’après Schiller. Le troisième aussi.
Le cinquième, le quarante-troisième, etc.
(Rires). Oui, bon, en ce qui concerne Guillaume Tell, il est logique qu’on en réalise un film en Suisse mais ceci dit, les premiers GuillaumeTell ne sont pas suisses. On fait tout autant, sinon plus, d’adaptations – maintenant, je mélange sciemment longs et courts métrages parce que en ce qui concerne ces premiers films, c’était souvent des films d’une bobine —, on a plus souvent parlé de Guillaume Tell dans les films étrangers qu’en Suisse même. C’était ce qui était intéressant à analyser. Qu’il y ait des films tournés d’après Guillaume Tell en Suisse, cela semblait l’évidence même. Seulement, il fallait toujours se poser la question : « – Pourquoi, et à quel moment, est-ce qu ‘on décide de filmer justement ce sujet-là. Quels intérêts le producteur avait-il ? Intérêts politiques ou simplement est-ce qu ‘il était bon homme d’affaires ? » Il sentait que le public voulait aller voir ce Tell-là, pour des raisons bien précises. C’est pour ça qu’on a un Guillaume Tell, enfin une sorte de variante de Guillaume Tell, Les origines de la Confédération en 1924, qui a été tellement soutenu par les instances du pays qu’on doit se dire qu’il faut absolument se méfier de ce genre de soutien. Il doit y avoir des intérêts là derrière. Effectivement, il s’agissait de rétablir une espèce de consensus national.
• Hitler, au début de sa carrière s’identifie à Guillaume Tell et finit par faire interdire plus tard toutes les allusions à Tell.
Tout à fait. On sait que la pièce de Schiller a été interdite par la suite, surtout pendant la guerre. Le régicide étant un sujet beaucoup trop délicat. Il faut bien dire que quand on parle de Tell, on parle automatiquement de Schiller et tout son théâtre se dresse contre le tyran avec un grand T. Donc tôt ou tard, Schiller devait disparaître ou en tout cas, ses pièces les plus évidentes et Guillaume Tellen tout premier lieu.
• L’absence de films dadaïstes m’a étonné.
En fait, ils n’ont pas fait de films à Zurich à ce moment-là. Ils avaient leur théâtre, ils faisaient des représentations théâtrales. Ou ils ont fait peut-être des films d’une manière tout à fait indé-pendante, hors circuit. Je n’en ai trouvé aucune trace.
• Dada n’a pas marqué la Suisse ?
Cinématographiquement, non… Certainement pas. Le surréalisme beaucoup plus. Il est intéressant en revanche de voir qu’un très grand nombre de professionnels du cinéma suisse, des scénaristes, des décorateurs, des cinéastes ont fait partie du mouvement dada, dans leur jeunesse.
• Il n’existe, entre 1897 et 1965, qu’un seul film suisse d’avant-garde, L’Obsession
de 1928 ?
Oui et ce film a disparu.
• Ce pays est réfractaire aux avant-gardes ?
Je crains qu’il faille bien se résoudre à la chose. Il y a eu une avant-garde en peinture. Mais regardez : même Dada en Suisse n’a pas fait long feu. Il faut se rendre à l’évidence : on est un pays très bourgeois. Le cinéma étant ce qu’il est, c’est-à-dire qu’il coûte horriblement cher, les quelques tentatives qui sont faites, notamment cette Obsession et puis un autre film que ce cinéaste qui vit toujours a fait, ont été des échecs complets, des échecs publics, prévisibles bien sûr. Mais ça suffit pour décou¬rager les quelques rares émules. On aurait pu espérer qu’un con¬grès comme celui de La Sarraz stimule quelque chose mais c’était quand même se faire des illusions. D’ailleurs le Congrès est historiquement important mais n’a eu aucune conséquence pratique. Le cinéma suisse a toujours été extrêmement dépendant de son public, or, le public étant ce qu’il était… Je crois qu’il n’y a jamais eu de public pour une forme de films d’art dans cette première moitié du XXe siècle en Suisse. Tous les films qui montraient un tant soit peu d’audace, je pense, par exemple à Rapt de Kirsanoff, ont été des échecs phéno¬ménaux.
• Trente-sept films ont été interdits à Zurich en 1921.
Eh bien, on ne peut que consta¬ter la chose avec effarement. C’est dire à quel point le cinéma était encore méprisé en tant que forme d’expression, à quel point les milieux dirigeants étaient puritains. Cette anecdote-là explique bien des choses quant au manque de hardiesse de tout un cinéma. C’est clair, c’est un cinéma qui était et est toujours resté, ou presque toujours, relativement sage, par la force des choses. La censure est omniprésente. Et quand il ne s’agit pas de censure policière ou même ecclésiastique, si vous voulez, il y a une autocensure qui est infiniment plus puis¬sante. Les Suisses sont les champions de l’autocensure, champions toutes catégories.
• Vous écrivez que le problème de la censure est sur¬ tout celui des limites intellectuelles de ceux qui l’exercent.
Bien sûr…
• Les associations d’artistes ont été encore plus protectionnistes pendant la guerre que d’habitude ?
Oui. Le problème s’est posé avec l’immigration. Qui immigrait ? Qui entrait en Suisse ? Les premiers visés étaient quand même les intellectuels et les créateurs. Il est évident que quand un Thomas Mann ou un Robert Musil étaient en Suisse, eh bien, indépendamment de l’honneur que cela signifiait pour la Suisse, ils étaient jalousés par les écrivains locaux, ce qui est en soi un peu absurde parce que ces gens ne leur arrivaient pas à la cheville. Il y a eu un bouclier protectionniste terrible. Tout particulièrement dans le milieu des comédiens parce qu’il y avait énormément de comédiens qui devaient fuir, soit parce qu’ils étaient israélites, soit pour des raisons politiques. Ce fut une lutte permanente entre les directeurs de théâtre et la police des étrangers pour expliquer pourquoi telle ou telle soubrette de Bienne ne pouvait pas faire l’affaire pour reprendre le rôle de la Mère Courage où brillait la grande Thérèse Giehse, à savoir la première dame du théâtre européen qui, par bonheur, se trouvait en Suisse dans ces années-là. Cela n’était pas évi¬dent pour la police des étrangers qui du reste n’allait pas au théâ¬tre. Il y a eu des exceptions dans cette police, des gens comme Oscar Duby, qui par la suite sont devenus directeurs de pro¬duction à la Praesens. C’est quasiment un geste de remerciement. Il y avait des fanatiques de théâtre et de cinéma qui connaissaient ces artistes et qui se sont personnellement mouillés, qui ont défendu la cause des artistes. Ce n’était pas toujours évident. Ce qui est frappant, par exemple, c’est aussi le cas Léopold Lindtberg. Dieu sait si il méritait de rester en Suisse et d’y travailler ! Il a pu rester et sur-tout travailler, dans le théâtre et le cinéma, grâce à la « Coupe Mussolini » qu’il a reçue en 1940. C’est un comble. C’est déjà amusant qu’un Juif reçoive une « Coupe Mussolini » mais en plus, c’est grâce à cette coupe, obte¬nue à Venise, que les autorités suisses ont été contraintes de le laisser derrière la caméra, au poste de metteur en scène au Schauspielhaus, etc.
• A l’exception de Roméo et Juliette au village tous les grands films suisses ont été faits par des étrangers, Rus¬ses, Belges, Autrichiens, Italiens, etc.
Oui. Certainement. Même Roméo et Juliette au villagea été fait par des étrangers. Si vous prenez la chose à la lettre, le cinéaste Hans Trommer est jusqu’à la fin de la guerre encore cinéaste allemand. C’est un Allemand. Et son coréalisateur, Valérien Schmidely était à moitié russe. Il a passé toute sa jeunesse en Union Soviétique et a été formé à l’école d’Eisenstein.
• Le protectionnisme existe-t-il toujours ?
Ce que l’on retrouve le plus souvent dans le cinéma, c’est des mélanges. C’est pour ça que j’en arrive à cette conclusion que le cinéma suisse n’est jamais entiè¬rement suisse, à moins d’être strictement régional. Ou alors c’est un produit international. Un cinéma national suisse, je n’y crois pas. Je n’en ai pas vu dans la période que j’analyse.
• Des artistes en dénoncent d’autres ?
C’est arrivé. Ma foi, je crains que ce n’est que trop humain. La situation se présenterait certainement de la même manière à l’étranger. Finalement, beaucoup de Suisses ont vécu exactement la même situation en France et en Allemagne. En France, à l’époque du Front populaire et du chômage, les Suisses ont dû rentrer exactement pour les mêmes raisons. De même qu’ils ont été chassés, boycottés dans le Reich aussi parce qu’ils étaient suisses donc étrangers. Je crois que c’est un phénomène général dans les années 30, dû au climat socio-politique du moment.
• Vous écrivez à peu presque les associations corporatives déterminent le profil idéologique des années 50 et sous des prétextes commerciaux exercent une censure préventive et politique. Ceci, en contradiction avec leurs statuts et encouragées par les autorités et la majorité des spectateurs.
C’est un fait. On ne l’a pas souvent dit. Il est évident que ces associations corporatives ne l’ont jamais signalé et souligné. C’est simplement la conclusion qu’on est forcé de tirer parce que 2 + 2 font 4. Si on lit leurs déclarations, elles sont violemment anti-communistes, parfois même hystériquement anti-rouges. Et puis, leur politique du film à l’intérieur du pays montre la chose avec évidence. Du reste quand on le leur signale, ils sont les derniers à le nier. Mais enfin, on ne l’a pas crié sur les toits. C’est une manière peut-être bien suisse de prendre parti sans oser vraiment l’afficher.
• Le premier film qui marche d’amont en aval est La tante ridiculisée d’Haller en 1915 ?
Oui, c’est cela. Je dirais que c’est le premier film qui est le produit d’une petite société. C’est la première tentative, en fait, de monter une société. On pourrait parler aussi de la Lumen-Films de Roth-Markus, mais on en connaît trop peu et de toute manière il travaillait beaucoup avec l’Italie. La Tante ridiculisée est un produit EOS de Bâle – EOS, société de distribution qui s’est improvisée société de production pour l’occasion, qui a construit des studios à Bâle, et qui pour cela a utilisé les artistes du Théâtre municipal de Bâle. Donc, il y a une toute première tentative de montrer quelque chose de con¬séquent, une production suivie effectivement, puisqu’on a droit alors à cinq, six petits films, des comédies, des histoires de détectives. Vu que ces films ont eu de la difficulté à être exploités, compte tenu de la guerre, peu à peu l’EOS s’est cantonné dans le documentaire qui est quand même beaucoup plus rentable. EOS Films a poursuivi sa politique de production mais en abandonnant totalement ou presque le film de fiction. EOS est peut-être la première société de cinéma importante dans le pays. EOS Distribution a survécu jusque dans les années 40.
• Des mêmes, la même année, sort Le cousin de Liestalqui s’inspire d’un réel et récent scandale bancaire.
Les gens de l’EOS qui étaient de la bonne bourgeoisie bâloise, je les vois difficilement donner dans le genre « contestation ». Finalement, on retrouve des choses similaires en Allemagne et en France, au même moment. Le cinéma se détache des schémas de comédies hérités du Bou¬levard et se tourne un peu vers les faits divers. On retrouve ce phénomène un peu partout en Europe.
• Le drame alpin devient la tarte à la crème de la cinématographie indigène depuis 1917 jusqu’en 1987 et le mélo d’alpage devient le seul genre national admissible à cause du nationalisme renforcé par la propagande touristique.
La montagne a été vue différemment selon les décennies. Tout au départ, la montagne était infiniment moins connue du citadin. Les déplacements étaient plus difficiles. Il est vrai que c’était un attrait à travers les romans populaires de l’époque. Et aussi pour l’étranger. Tout de suite, c’est devenu un élément exportable. Donc ces premiers drames obéissaient à des directives, inconsciemment, bien sûr, de l’Office du Tourisme qui venait de naître. Ensuite, un peu dans cette même logique, par réaction aux drames alpestres tournés n’importe comment par n’importe qui, les milieux du Club alpin des années 20 se sont aussi lancés dans l’aventure, ont hissé leurs caméras sur les pics et ont tenu à montrer de manière quasiment documentaire – il s’est fait une infinité de documentaires à ce moment-là sur l’escalade — comment on escalade une montagne, quels sont les dangers que doit affronter l’alpiniste. Et ils le faisaient alors avec de véritables guides et plus du tout avec des décors de cinéma. Prenez l’exemple de 1917, Le guide alpin qui est justement un film de la catégorie précédente. Il mélange allègrement les prises de vue effectuées en haute montagne avec des toiles peintes représentant des glaciers.
• Vous écrivez : « Par un curieux retour des choses, les défenseurs les plus acharnés de cette fausse authenticité seront les mêmes qui livreront les trames les plus invraisemblables, psychologiquement parlant, et les récits les plus mensongers. »
C’est absolument frappant de voir que les gens qui insistaient à tout prix pour montrer la montagne, la varappe telle qu’elle est et des têtes de Valaisans on ne peut plus burinées et authentiques, collaient tous ces éléments sur une trame parfaitement grotesque et invraisemblable, mélodramatique et tirée de la littérature feuilletonesque du XIXe siècle, moralisante à souhait et complètement à côté de la réalité. Tout ceci a culminé dans la représentation de la montagne des années 30. La montagne devient cette fois le centre de l’action. Elle est mythifiée. Elle prend vie toute seule. Elle est une force démoniaque ou bénéfique, comme on voudra, une chose à laquelle l’homme doit se mesurer, qui le détruit ou le modifie entièrement.
• Vous citez Siegfried Kracauer sur l’aspect nazi, totalitaire de la représentation des cimes.
Ça, c’est absolument clair. La montagne pouvait être bénéfique en ce qu’elle modifiait entièrement le citadin. De toute manière c’est toujours la montagne vue par des citadins.
• Et elle guérit…
Oui. Il y a un titre : Viens à la montagne et tu seras guéri. La priorité est donnée au sentiment. Kracauer parle « d’intuition féminine » dans le sens qu’on n’aborde pas la montagne de manière rationnelle, on l’aborde avec une espèce d’enthousiasme, on se laisse imprégner par la majesté.
• En quantité, quel est le rapport des productions fiction/documentaire ? Et en qualité ?
Pfuiouh… En ne faisant pas la distinction entre longs et courts métrages…
• En mentionnant que la production suisse entre 1896 et 1965, soit 315 films représente la production annuelle de l’Allemagne ou de la France, une bonne année.
Je dirais un film de fiction pour quatre documentaires. Au mini¬mum ! Et encore… Est-ce qu’on peut comparer la qualité des documentaires et des fictions ? Le documentaire a toujours été, sans vouloir être péjoratif, une solution de facilité dans la mesure où il est infiniment meil¬leur marché, moins compliqué. Un documentaire peut se faire avec deux personnes ou même une seule. Par conséquent, il n’y a que les frais de déplacement et la pellicule à payer. Et c’était rapidement rentable comme produit d’exportation. Les Américains raffolent des Alpes, les Allemands aussi. Ils ache¬taient et projetaient des films tournés en Suisse un peu comme nous aujourd’hui regardons des films sur les Esquimaux ou sur l’Afrique. Donc, d’emblée, c’était un «genre» qui ne présentait pas beaucoup de risques.
• Yersin et Murer amènent-ils une renaissance du documentaire ?
Leurs documentaires sont d’un tout autre style dans la mesure où ils sont critiques. Les docu-mentaires des années 20-30 sont beaucoup plus, je pense, des reportages que des enquêtes à proprement parler. Il n’y a pas eu de très grands talents de documentaristes en Suisse à part Duvanel qui est un nom qui sort du lot, et Brandt bien sûr, mais qui est quelqu’un de tout à fait à part. Au fait, je le compte dans la période qui suit celle de mon livre. Des gens qui ont une œuvre cohérente en tant que documentariste… Duvanel a toujours vécu de films de commande mais enfin c’est un homme qui a mis ses images au service de différentes idéologies. C’est comme Josef Dahinden. C’étaient les cinéastes favoris de la Défense spirituelle nationale, de toute cette imagerie-là. Ce sont des reportages habiles, très bien faits. De même, la dynastie des Porchet était certainement des docu¬mentaristes qui se défendaient bien professionnellement. Enfin, si on pense à ce que Flaherty faisait, nous sommes loin du compte. Les documentaires, me semble-t-il, plus encore que la fiction, sont aujourd’hui intéressants à étudier surtout dans leurs aspects politiques et idéologiques.
• Vous semblez mépriser la sociologie, vous écrivez : Propos à verser au dossier « cinéma et sociologie »…
Tout au contraire. Il me semble que cet ouvrage est éminemment utilisable justement par les sociologues. Il n’y a pas l’ombre d’un mépris. Mon approche est, modestement, sinon prioritairement, aussi sociologique.
• Vous considérez-vous comme marxiste ?
Non, pas du tout. Le marxisme est un filtre qu’on est en droit d’utiliser dans la mesure où l’on garde une certaine distance avec l’idéologie qui y est attachée. Mais Marx a dit des choses parfaitement justes pour son époque. C’est des faits absolument irréfutables. Quand Marx analysait les rapports de classes, eh bien, on est forcé de se dire qu’il y a du vrai. Mais je tiens à le préciser, mon ouvrage s’est souvent fait contre certains livres, qui sont eux, alors, très franchement marxistes. Je pense aux ouvrages sur le cinéma suisse de Wider et Aeppli face auxquels je suis extrêmement critique. Je suis le premier surpris d’être qualifié de marxiste dans mon approche. J’utilise des éléments, des analyses. J’accepte un certain nombre d’analyses qui ont, entre autres, aussi été faites par Marx. C’est tout.
• Si on essaie de comprendre votre système de jugement, on peut en conclure que pour vous un bon film est nécessairement un film critique.
Pas nécessairement. Je suis un fanatique de la comédie musicale américaine, j’adore les westerns, le cinéma de cape et d’épée et ces sortes de choses qui sont tout sauf critiques. D’ailleurs les films que j’aime dans le cinéma suisse, à savoir par exemple Rapt, ne sont pas des films critiques. Pour moi, la valeur est là, elle est strictement esthétique.
• Ça se manifeste surtout négativement. Quand un film vous déplaît, vous dites qu’il ne remet pas en cause la situation qu’il décrit.
C’est juste, mais la question serait : « Est-ce qu’un cinéaste est lucide ou pas ! » Rien d’autre. Un cinéaste qui vit dans une époque aussi difficile que le fut, par exemple celle des années 30, devait d’une manière ou d’une autre, se poser des questions fondamentales. Alors, il le fait avec l’esprit plus ou moins clair. Ceci dit, quand un cinéaste faisait un film d’amusement, une comédie brillante, ça vaut toutes les critiques du monde. Ce n’est pas du tout la critique en elle-même qui prime. Il faut bien dire, que en ce qui concerne le cinéma suisse, il n’y a pas eu beaucoup de grands amuseurs. Nous n’avons, hélas, jamais eu un Lubitsch qui est pour moi le cinéaste numéro un au monde. Ni un Mankiewicz, ni un Ophuls. Par conséquent, ce qui est intéressant dans le cinéma suisse, c’est son engagement ou son non-engagement politique. Et je crois que je reconnais là des vertus ou des défauts typiquement helvétiques ! L’Helvéte n’est pas un esthète ! Et c’est pour ça que les considérations esthétiques, par la force des choses, en raison de la matière elle-même, sont au deuxième plan. Bon, j’en ai toujours tenu compte. Si vous prenez les films adaptés de Jeremias Gotthelf dans les années 50, ce sont des films où il y a un jugement qui n’est plus marxiste mais un jugement de moraliste.
• On peut dire qu’il est chrétien ?
Oui, bien sûr, en partant de Gotthelf qui est chrétien. Je l’accepte tout autant dans la mesure où le cinéaste est conséquent. Alors que ce sont des films qui ont été rejetés et violemment attaqués par les marxistes de service.
• Vos analyses sont donc produites par les objets eux-mêmes. Le marché suisse est insuffisant. Il produit avec difficulté des films très investis sur des sujets suisses. Il n’y a pas de production commerciale courante.
J’aurais bien voulu avoir comme matière beaucoup plus de films de comédie, par exemple des comédies de format national ou international. Alors que les comédies faites en Suisse sont généralement des farces régionales. Il fallait prendre la matière telle qu’elle était. Disons que j’ai plutôt des sympathies très nettement anarchistes… (Rires) Si on me le demande…
• Montgomery Clift sur Les anges marquésse bat contre le scénario. Sa professionnalisation lui permet de s’affirmer. C’est ce que ne peuvent pas faire les collaborateurs suisses d’un film suisse.
Oui et non. J’ai trouvé dans ce conflit entre Montgomery Clift et son producteur Wechsler,
une lutte quasiment archétypale entre le créateur et le producteur. On trouve des conflits
similaires à Hollywood même.
• Mais on n’en trouve jamais dans le cinéma suisse.
Il faut bien comprendre que toute cette industrie du cinéma suisse, c’était accidentellement une industrie. Les gens qui travaillaient devant la caméra n’y étaient qu’accessoirement, entre deux pièces de théâtre, deux pièces radiophoniques et par conséquent, il n’y avait pas du tout cette même prise en main d’acteurs de cinéma. On a quelques rares exemples de gens qui ont un talent cent pour cent cinématographique devant la caméra. Je pense à Max Haufler et à Michel Simon. Haufler est un peu plus jeune que Simon. Il a commencé comme peintre, il a continué comme cinéaste, il a fini contre son gré comme acteur. Il a tourné à Hollywood et avec Orson Welles. Il y a aussi, parmi ces gens, cette autre idole des Zurichois qui s’appelait Emil Hegetschweiler, qui est fabuleux, qui est une sorte de Raimu local, et qui n’a aucune gêne devant la caméra, qui n’exagère jamais, qui peut parfaitement maîtriser le underplaying à l’américaine. Ce sont des phénomènes. C’est qu’il n’existait pas, qu’il n’a jamais existé d’école de cinéma suivie pour les comédiens. Jacques Feyder en sait quelque chose, lui qui désespérait d’enseigner le jeu cinématographique à ses élèves à Genève.
• Le problème est resté actuel. Ce qui est le cas de beaucoup de choses qui sont dans votre livre. Par exemple, vous dites d’un des premiers producteurs suisses, Tombet, « il voit trop grand et fait trop petit, parle beaucoup mais se satisfait de peu ; sans expérience, il calcule mal ses investissements, économisant là où il faudrait dépenser et inversement. »
Oui, oui, alors ça c’est le cliché du mauvais producteur et hélas de bien des gens qui se sont lancés dans le cinéma et qui y ont perdu santé et fortune.
• Cela dure bien après 1965.
Tout à fait. Cela tient sans doute aussi au statut très pré¬caire qu’a eu le cinéma pendant si longtemps en Suisse. On ne considère pas le cinéma comme un métier honorable, producteur de cinéma comme un métier présentable. Les deux seuls producteurs qu’on ait eus en Suisse, ou les trois, c’était Lazar Wechsler pour la Praesens, d’un format immense, puis ce curieux bonhomme, Stephan Markus, producteur lettré qui fait aussi une carrière assez impressionnante en France et, pour l’après-guerre, Heinrich Fueter qui a aussi travaillé à la Gloria.
• Et Dietrich !
Ah oui ! Il est aujourd’hui encore plus qu’actif.
• C’est le plus grand producteur de films pornos d’Europe ?
Il le fut. Il s’est rangé. Il ne donne plus que dans les films d’action. De temps à autre, il finance un film de prestige. Mais en voilà un qui brasse des millions. C’est certainement un phénomène. C’est un homme extrêmement gai et jovial et qui, curieusement, ne se prend pas au sérieux. Il est incapable de vous dire quels films il a tourné. Il n’est pas du tout au clair quant à sa production.
• C’est extraordinaire que les Suisses soient de grands producteurs de porno.
• Cette découverte m’a absolument ravi, enchanté. Quand on voit, d’un autre côté, à quel point cette production a pu être parfois timorée, puritaine, et de l’autre, qu’existait une production hyper polissonne et cachée. Peut-être que ça aussi, c’est très suisse.
• Les Suisses n’adaptent quasiment jamais de romans étrangers.
Non, effectivement. C’était presque considéré comme déshonorant et infamant d’aborder une littérature étrangère. Il est vrai qu’il y a une rengaine qu’on retrouve chaque décennie : « Nous avons tellement de bons romanciers, il y a de bons sujets chez nous, sans parler des paysages, pourquoi aller choisir des sujets ailleurs ? » On peut mettre ça sur le dos du nationalisme ambiant des années 30-40. C’est vrai. Par ailleurs, adapter des romans étrangers pose certains problèmes financiers. Il faut les filmer dans des décors appropriés, et éventuellement des décors qui ne sont pas suisses, et ça, ça nécessite des investissements qui ne sont probablement pas à la portée de la production locale.
• Je suis quand même très frappé par le nationalisme.
C’est juste. Le Suisse est très conscient de ses valeurs, beaucoup trop. Un Durrenmatt ou un Frisch se sont amplement moqués de la chose. Je crois que ça s’est simplement reflété au cinéma. D’autant plus que, compte tenu de la nature du média, transparaît à chaque image à quel point le Suisse est conscient de ce qu’il croit défendre, des valeurs qu’il s’imagine défendre. Le Suisse se fait une image de lui-même.
• Cette image est rurale. L’une de vos descriptions dit que le vrai Suisse est robuste, discipliné et campagnard et que sa compagne est saine, silencieuse, pudi¬que et travailleuse.
Oui, mais cette description-là n’est pas nécessairement celle du Suisse des années 20, des années 10 ou des années 50. En fait, c’est très étroitement lié à toute l’idéologie de la Défense spirituelle nationale, une idéologie qui était d’inspiration paysanne. A travers les conseillers fédéraux qui incarnaient un peu toute cette idéologie, on a essayé de trouver une sorte d’équivalent au Blutenboden nazi pour créer une espèce de contre-force. Au fait, quand j’en parle ce n’est pas nécessairement dans l’esprit de le critiquer. J’essaie au contraire de le comprendre. Peut-être que cette simplification, agaçante à plus d’un titre était nécessaire à un moment donné pour mobiliser les masses, pour créer un consensus national. L’histoire donne raison à ces gens. Il n’y en a pas eu autrement, donc il faut croire qu’ils ont mobilisé les clichés, les archétypes, sinon justes, en tout cas adéquats, compte tenu de la situation politique du moment.
• Il y a un problème d’ensemble. Il n’y a, par exemple et quelles que soient les années, pas de goût à présenter la passion. L’aspect global est : les Suisses ont-ils besoin d’art ? Un peuple qui cantonné la femme dans un rôle édifiant peut-il prétendre à l’art ?
On pourrait répondre que cette absence de passion est à la fois la faiblesse et la force du pays. C’est ce qui l’a protégé du nazisme, phénomène passionnel et complètement irrationnel. Par ailleurs, en même temps, c’est bien ça qui a parfois rendu la vie artistique du pays si terne. Que vous répondre d’autre ? Il est vrai que tous les artistes qui ont fêté, qui ont chanté la passion sont des individus absolument isolés, dans le cinéma comme dans les autres arts. Voyez le cas d’Eve, un film tessinois d’inspiration surréaliste qui a été complètement boy¬cotté au point que le cameraman m’a avoué les larmes aux yeux avoir détruit le film, estimant que de toute manière c’était un ouvrage excessif que personne ne voudrait voir.
• Il y a un sur-moi local… terrifiant.
On en a des preuves écrites dès 1840 – début du Journal d’Amiel – et ça dure jusqu’à aujourd’hui. Il y a une anecdote amusante à propos de Markus. Il a l’esprit ouvert donc on lui reproche de ne pas être assez suisse. C’est typique. Rien n’est plus terrible pour un Suisse que l’esprit cosmopolite. Je ne sais pas si c’est toujours le cas mais pour les décennies analysées, c’est un fait.
• Ici, nous vivons face à du paternalisme et du moralisme. Votre livre prouve que
c’est récurrent.
C’est un aspect qui m’a tout de suite frappé parce que j’ai passé pratiquement toute ma vie à l’étranger. Mes parents sont diplomates donc, je suis allé à l’école en Suède, en Allemagne, en Espagne. J’ai suivi mes parents dans les pays arabes. Quand je revenais en Suisse, c’est toujours cet aspect-là du pays qui me frappait, qui souvent m’irritait ou m’amusait, mais il a bien fallu essayer de cerner de la manière la plus objective possible la création dans le pays. C’est d’autant plus frappant dans le cinéma que c’est un art collectif. Ce cinéma, jusque dans les années 60, n’est pas, en aucun cas, un cinéma d’auteur. C’est un cinéma de producteur comme partout. C’est la Nouvelle Vague qui a imposé peu à peu la notion d’au-teur et le cinéaste lui-même est devenu, ou redevenu depuis l’ère du muet, le père de sa création. Tandis que dans les années 20, 30-40 très fortement, c’est un cinéma qui porte le label Praesens, Gloria, etc. et qui est le produit d’une collectivité. Les mêmes scénaristes, cameramen, plus ou moins les mêmes acteurs… On se retrouve en famille mais ça reste un phéno¬mène collectif. Alors il est difficile que transparaisse autre chose qu’une mentalité bien de chez nous. Malgré les mélanges cosmopolites.
• Je vous cite: « …Manuel Gasser dénonce cette crainte typiquement helvétique, cette tendance à éviter systématique¬ment les interrogations et les problèmes de notre temps qui se retrouvent dans tous les domaines de l’art. »
C’est une phrase synthétique mais c’est un cri entendu à chaque moment. Je crois que Léopold Lindtberg me l’a dit dans une interview assez clairement. Il a expliqué que finalement on pouvait être content, pour prendre le cadre de la Praesens qui était la maison de production la plus dynamique, qu’ils aient pu dire ce qu’ils ont dit. Les tenants de cette société étaient tous d’essence bourgeoise et fondamentalement très peu critiques. Toute illustration un tant soi peu non-conformiste du pays choquait.
• La Praesens fut la plus grosse maison de production du pays ?
Oui. Ceci dit, la Preasens a fait des films qui ont abordé des sujets extrêmement controver-sés, avec courage. On peut regretter qu’il n’y en ait pas eu plus, mais je crois que ce n’était simplement pas possible. D’une part, en raison de l’autocensure et d’autre part, en raison, pour les années de guerre, de la censure militaire omniprésente. Qui a eu accès aux dos-siers de cette censure aux Archives nationales, en reste assis de voir à quel point ces gens étaient pusillanimes et ridicules.
• Un acteur se nettoie les ongles avec une baïonnette…
Voilà, exactement. C’est Alfred Rasser, le grand acteur de cabaret qui a fini comme conseiller national. La scène a été coupée parce qu’un soldat suisse ne fait pas une chose pareille. Pendant la guerre, on a censuré des photos et des scènes de films où il y avait des militaires, des soldats qui avaient le col ouvert. On sait bien qu’un soldat suisse n’a jamais le col ouvert !
• Dès qu’un sous-officier sympathise avec un soldat, il y a de violentes critiques parce qu’il faut respecter la hiérarchie.
Tout à fait. Et je ne pense pas que ce soit là une remarque ou une observation marxiste ! N’importe qui, plus ou moins sain d’esprit, ne peut que sourire en entendant des remarques pareilles. Ou on a les pieds sur terre ou on ne les a pas.
• C’est vraiment bouffon.
Bouffon d’une part et d’autre part c’était une réalité extrêmement oppressive. Des films comme ceux de la Praesens, le fait qu’ils aient vu le jour, eu un certain succès, est en soi déjà un phénomène.
• En prenant un domaine particulier, le cinéma, vous arrivez à démontrer qu’Hitler se préparait à envahir la Suisse. Il y a des infiltrations réelles et un journaliste de l’époque dit que dans un film la Suisse est décrite comme une province allemande, un lieu de villégiature pour le repos du guerrier.
Ça ne fait pas l’ombre d’un doute. J’ai revu ce film dernièrement en vidéo. C’est frappant de voir à quel point la Suisse et l’image de la Suisse ont été cinématographiquement annexés. C’était les premiers pas vers une annexion réelle. Il suffit de suivre ce qui c’est fait en Autriche entre 1934 et 1938 pour se dire « Attention, il se prépare strictement la même chose en Suisse ». En Suisse Alémanique bien sûr… C’était la seule partie inté¬ressante pour le Reich. Alors, c ‘ est tout aussi bien au niveau de ce qui se passe sur l’écran, de ce qui est raconté, c’est-à-dire tout ce cinéma tendancieux qui cherche à montrer qu’il n’y a aucune différence de culture et d’identité entre l’Allemand et le Suisse allemand, que sur le plan écono¬mique, les diverses tentatives de racheter les studios, de s’infil¬trer dans les sociétés de production suisses, de venir sur le terrain avec des Allemands en Suisse, de s’implanter, de faire de l’espionnage, de s’adonner au trafic de devises. Il y avait là tout un travail souterrain qu’il faut bien mettre en rapport avec les mouvements frontistes de l’époque qui comme par hasard fleurissent exactement au même moment et dans les mêmes villes.
• Le plus grand producteur, Wechsler, est juif. Se bât-il contre les nazis ?
Oui. Très vite. Wechsler, qui avait d’abord tenté de s’implanter en Allemagne, s’est très vite rendu compte, au début des années 30, que sa production n’avait pas d’avenir à Berlin. En plus, l’un des films qu’il avait financé à Berlin et qui illustrait la fameuse bataille de Tannenberg a été complètement dévié thématiquement, et est devenu un film à la gloire de l’extrême-droite allemande, un film qui a été utilisé ensuite comme arme des nazis. On s’est évidemment moqué du Juif Wechsler qui s’était fait rouler par les Allemands. A partir de ce moment-là, Wechsler a, tout comme tant d’autres, tenté de se retrancher dans le documentaire. Finalement, il a eu le courage de monter une production tout à fait locale en dialecte. Strictement en dialecte. Il savait pertinemment que s’il faisait une comédie zurichoise, il pouvait l’exploiter à Zurich et éventuellement à Berne, plus difficilement à Bâle, puisque les Bâlois n’aiment pas les Zurichois. Enfin, une comédie qui coûte peu et qui soit viable et rentable. Cet homme était malin, non seulement il distribuait des films, mais il avait une société qui fabriquait des films publicitaires très demandés. Par conséquent il avait le noyau technique et toujours les fonds suffisants pour faire avancer la production locale. Il a été le premier à imposer un cinéma en dialecte et on sait très bien que le cinéma en dialecte à ce moment-là, en 1933-34 a acquis une dimension tout à fait inespérée, une dimension politique puisque c’était encore la manière la plus définitive d’affirmer son identité suisse face au « hochdeutsch » du Reich, une manière de bien faire comprendre que les boches, c’était des étrangers qu’on ne voulait pas. Curieusement, on retrouve dans un petit film de la Praesens, strictement en dialecte zurichois, des acteurs et même le cinéaste qui sont des étrangers ! Ce sont des fugitifs, des immigrés. Lindtberg, qui est la figure de proue de cette immi¬gration, commence justement dans le cadre de cette petite pro¬duction, très gauche, qui alors acquiert, bien malgré elle, une dimension politique. Il faut dire que ces premières comédies, si vous les regardez telles quelles, en ignorant tout contexte, n’ont absolument rien de politique. Les sujets, ce sont des farces, du vaudeville du siècle passé. Le fait que l’on ait fabriqué ces farces à ce moment-là, avec ces gens-là leur succès signifie quel¬que chose.
• A un moment donné, toute participation aux activités de la Praesens entraîne le retrait du permis de travail dans le Reich.
Exactement. Donc, à Berlin, on était parfaitement au courant de ce qui se faisait en Suisse, qui étaient les producteurs actifs, quelles étaient leurs intentions ou leurs opinions. Il n’y a pas de mystère.
• Il y a un mystère. En 1943, la Praesens prend dans son conseil d’administration, l’ex-fer de lance de la pénétration nazie, Ralph Scotoni. Vous écrivez : …les affaires sont les affaires…
Je pense que Scotoni a dû, sur le tard, admettre qu’il s’était trompé. Si Scotoni avait conti-nué d’afficher ses opinions et n’avait pas fait une sorte de mea culpa, Wechsler ne l’aurait jamais pris dans son conseil d’administration. Des gens qui en faisaient partie comme Boveri ou Duttweiler, n’auraient jamais toléré ce monsieur ! Après la guerre, il y a eu quelques personnes qui ont été exclues de la corporation, mais généralement, on a passé tout cela sous silence. Il est vrai que beaucoup de ces gens qui ont sympathisé avec les nazis dans les années 30 sont revenus de loin. Je ne veux pas dire qu’ils aient tourné casaque, mais enfin pour les milieux bourgeois, pour la droite en particulier, le Hitler des années 30 tel qu’il se présentait à travers l’actualité et la presse, pouvait, semblait attachant pour peu que vous ayez peur de la gauche. La fièvre nationaliste aidant, je crois qu’un glissement pouvait vite arriver. Gottlieb Duttweiler est certainement l’un des géants dans cette affaire, un antifasciste convaincu. Il a soutenu la production du cinéma suisse déjà pendant la guerre et de plus en plus après la guerre. Ce n’est pas un secret, il a été l’un des piliers de la Praesens. Il en aurait fallu beaucoup comme lui dans le pays.
• L’idéologie suisse pour le XIXe siècle se résume à trois hagiographies: Dufour, Pestalozzi et Dunant, unité de la Suisse, paternalisme et CICR.
C’est clair. Donc, il est normal que ces trois personnages aient été intégrés d’emblée à toute l’imagerie de la Défense spirituelle à un moment où l’on cherchait des modèles, des grands hommes.
• Pourquoi les projets de films sur Pestalozzi ne se réalisent-ils pas ?
Sans doute à cause de sa biographie, sa jeunesse et en particulier aussi les errements de sa vieillesse, les erreurs… Il y a eu des banqueroutes plus ou moins frauduleuses, toute une histoire qui est très gênante et en plus ses idées très rousseauistes qui, si on les regarde de plus près, n’étaient pas très favorables à l’establishment.
• Pas de films sur Dunant pour les mêmes raisons ?
Ces hommes étaient beaucoup plus contestataires qu’on veut l’admettre. Alors chaque fois qu’il y avait des projets qui dépassaient la simple hagiogra¬phie de livres scolaires, il y avait des vetos.
• Il n’y a pas de longs métrages de fiction en Suisse romande entre 1942 et 1966.
Effectivement, il n’y a plus qu’une production sporadique de courts métrages. La Suisse romande semble dormir du sommeil de la Belle au bois dormant. Comment expliquer cela ? A quoi rattacher cela ? D’une part, il n’y a pas beaucoup de films romands dans les années 30, non plus. J’essaie de l’expliquer dans le chapitre concernant les tâtonnements du cinéma romand dans les années 40. Il est vrai que l’infrastructure, la capitale économique du pays est restée Zurich. En Suisse romande, à la fois un esprit très provincial, très protestant et moralisant, est resté facteur déterminant.
• Dans ce sens-là, la génération de 1965 est extraordinaire. C’est la première génération d’artistes qui ne s’exile pas.
En effet, c’est une rupture totale. Parce que les possibilités de s’exprimer plus ou moins librement lui ont été données. Par la télévision qui a été le facteur dominant.
• Les Suisses allemands ont-ils une littérature populaire ?
Oui, toute une littérature champêtre et montagnarde à la Spyri qui est certainement une littérature mensongère mais qui est immensément populaire, à l’étranger, presque plus qu’en Suisse.
• Le cabaret Le Cornichon, est-il un phénomène important ?
Ah oui ! Le Cornichon a été une arme politique de premier ordre. Voilà une activité anti-fasciste par excellence. Il a été sans doute le cabaret le plus virulent, et pas seulement en Suisse, de toute cette période. Mais c’est une activité qui eut été totalement impossible à l’écran parce que ce que l’on tolérait sur la petite scène du cabaret était impensable à l’écran où des milliers de gens pouvaient le voir, et où la censure s’en mêlait. Du reste l’his-toire du Cornichon est une lutte permanente avec les autorités, avec la police, avec les interventions des consulats étrangers, avec les pressions les plus diverses. Enfin, c’est ça le cabaret, dans des périodes pareilles. Tout le cinéma suisse des années 30-40 et 50 vient du Cornichon. A partir du moment où les grands cabarets à Berlin, avec Brecht, Weil et tous ces gens, ont disparu, c’est Zurich qui a repris le flambeau et les gens qui brillaient à Berlin sont venus à Zurich. Il y avait aussi le fameux cabaret, Le Moulin à poivre à Zurich, qui était un cabaret d’émigrants et qui a été littéralement boycotté et chassé de Zurich par l’extrême-droite. Les gens du Pfeffermùhle se sont en partie recyclés au Cornichon. C’était une pépinière, à la fois artistique et politique très importante et très vivante. Il n’y a pas un scénariste, un metteur en scène, un comédien qui n’ait pas fait ses premières armes au cabaret.
• Que pensez-vous des films de Dindo ?
Je trouve Dindo extrêmement habile mais parfois à la limite de la démagogie. J’ai l’impression que des films comme son dernier, Dani, Michi, Renato & Max qui fait appel aux émotions du public de manière très subtile, pourrait dire exactement l’inverse avec autant de force. Le public réagit émotionnellement à ces images. Elles ont parfois l’apparence d’un procès rationnel avec des preuves. Finalement, sur les faits qu’il rapporte, les liens qu’il y a entre ces faits, je ne suis plus du tout aussi persuadé de la chose. Je tire mon chapeau pour l’argumentation, la subtilité de l’argumentation mais je ne suis pas toujours sûr… Je ne doute pas de l’honnêteté de Dindo ! C’est certainement sa conviction. C’est un ami. Cet homme n’essaie jamais de tromper son public, mais son cinéma respire parfois un peu trop le parti pris. Si vous voulez, Dindo m’est extrêmement sympathique parce que j’estime que des hommes comme lui sont nécessaires dans ce pays. Il n’y en a pas assez. Mais il n’illustre jamais toute la vérité, c’est peut-être le seul reproche que je lui ferais. Peut-être qu’il ne cherche pas à être objectif. Il prend consciemment parti, quitte à se tromper. Il a le courage de ses opinions et je les respecte entièrement.
• Il semble plus cultivé par rapport à l’histoire du cinéma suisse que les Romands.
C’est juste, mais ça tient à la nature même du cinéma aléma¬nique qui est un cinéma politi-quement et socialement plus engagé. Le cinéma romand est plutôt cinéma psychologique. C’est un phénomène général. Par dessus le marché, les Suisses allemands vivent avec leur cinéma, vivent avec les anciens films de leur cinéma. Ils peuvent s’y référer. Ils créent souvent à partir de ces anciens films. On ne peut pas faire la même chose en Romandie. On n’a pas d’anciens films, muets mis à part mais ils sont si lointains, ils n’existent en partie même plus. Le Suisse alémanique a tout un héritage cinématographique, plus ou moins lourd, agaçant, avec lequel il doit se confronter. Evidemment, il est passionnant de lire le nouveau cinéma à tra¬vers ce prisme-là.
• Considérez-vous Godard comme un cinéaste suisse ?
Je crains que oui. De par son personnage déjà. Quant à savoir si son cinéma est suisse, je trouve que la question est mal posée. En tant que personnage, oui, il a un côté très suisse. Godard, pour moi, n’est certai¬nement pas un Parisien. Il détonne totalement dans le petit monde du cinéma parisien.
• Que vaut Don Juan ou la solituded’Oltramare?
Je vous avouerai que je ne l’ai pas lu. Il a du talent puisqu’il a gagné des prix littéraires. Mais il était surtout apprécié par les dames parce que c’était un beau garçon. Il s’est attaqué de manière honteuse à Levy-Lansac dans son canard, dans son torchon fasciste. Il a insulté Levy-Lansac qui l’a attendu à un coin de rue et puis l’a assommé. Ce qui est de bonne guerre.
• On pourrait continuer comme ça à l’infini. J’espère que les gens liront votre livre.
Ce n’est pas un livre qui est fait pour être lu. C’est un livre à consulter, feuilleter, puis, de temps à autre, on choisit un cha¬pitre. Ce serait un marathon épouvantable de lire ce livre comme cela d’une traite. Enfin, vous l’avez fait, chapeau. Moi, je l’ai fait parce que je n’avais pas le choix. (Rires).
• On pourrait donner un exemple de critique bouffonne. «La nuit sans permission fait encore d’autres mécontents, à lire les articles rageurs de «L’Association suisse des hôteliers» où le film est perçu comme une insulte à l’hôtellerie nationale. La sommelière – qui n ‘offre que « du bourgogne ou d’autres cuvées étrangères» – se laisse payer une boisson par un client (chose «défendue par la loi»), lui fait les yeux doux «comme une prostituée » et l’invite à passer la nuit dans sa chambre ! Son com¬portement est jugé non seule¬ment «invraisemblable» mais «humiliant pour nos employées suisses simples, honnêtes et sérieuses».
C’est clair qu’une telle réaction du public, ou d’une partie du public, – de toute manière le film a été un échec épouvanta¬ble, un four sans pareil qui a mis en péril la Praesens – montrait bien les limites du réalisme en Suisse, en particulier pendant ces années de guerre où on vou¬lait voir des Suisses idéalisés, n’ayant en aucun cas un com¬portement normal. Toute ques¬tion de sexualité mise à part, où là, on a des réactions quasiment hystériques. Si par hasard, cette femme avait couché avec le sol¬dat, qui plus est, était un déserteur ! Une femme suisse, on le sait très bien ne couche jamais avec des déserteurs.
• La Suissesse est brimée au cinéma ?
Oui, oui. Il existe d’ailleurs une thèse qui vient de sortir sur l’image du père dans le cinéma suisse qui en dit long… Mis à part des films, comme ce film tessinois de 1939, Eve, qui est l’exception qui confirme la règle.
• Votre analyse du heimat roman est marxiste. C’est un refuge doucereux et nostalgique fabriqué pour les masses déracinées du début de l’industrialisation.
Je ne vois pas ce qu’il y a de marxiste. C’est simplement un constat. Il y a sujets ruraux et il y a sujets ruraux. Si vous prenez Murer, c’est tout autre chose dans la mesure où il ne s’agit pas de présenter une idéalisation doucereuse qui est complètement à côté de la vérité. En revanche le heimatfilm est, dans son essence même, mensonger. Mais enfin, on peut dire la même chose sur toute la littérature de kiosque. Là, Murer fait du travail extrêmement utile. Ceci dit, le heimatfilm a sa fonction sociologique. Par conséquent, c’est dans une perspective sociologique qu’il faut l’aborder. Dans une perspective esthétique, ça n’a aucune espèce d’intérêt. Ces films sont généralement mauvais. En revanche, il est passion¬nant de lire les mentalités d’une époque à travers ces films .C’est fondamental. C’est pour ça que le cinéma en dit souvent infini¬ment plus qu’un autre art, par le fait que c’est un phénomène de masse.
• Allez-vous continuer, publier un volume sur l‘après 1965 ?
Je risque d’y être contraint. C’est envisagé. D’abord parce que ce type d’ouvrage est au programme d’une cinémathèque nationale. Si ce n’est pas la Cinémathèque qui le fait, qui le fait, sinon ? Elle est la première concernée et sans doute la mieux informée. Dans la mesure où je collabore avec la Cinémathèque, et que j’ai moi-même mes fichiers, ma documentation, c’est normal qu’on envisage une suite. On en a déjà parlé. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra.
• Vous avez une idée de la quantité de films que cela représente ?
On a tourné depuis 1965 presque deux fois plus de films que pendant la décennie précédente. Les difficultés pour les retrouver seront très différentes. On a affaire à des gens qui sont toujours vivants, éventuellement toujours actifs. Donc il n’y a plus d’archéologie du cinéma, de travail de détective pour retrouver sinon les films, au moins leurs scénarios ou pour savoir de quoi ils parlaient, pouvoir reconstruire leur histoire de production. Ce sera une approche moins historique. La distance manque. Il y aura des difficultés pour localiser les x films qui sortent à Soleure et qui disparaissent définitivement dans les tiroirs parce que per¬sonne ne veut les voir. Mais la suite se fera certainement et je risque fort d’être de la partie. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que Buache y jouera un rôle pré¬pondérant. Freddy Buache a été un des grands moteurs de ce renouveau du cinéma suisse. Il est le témoin privilégié de cette renaissance. Donc, si ça se fait, ce ne pourra être qu’avec lui.
• Qu’est-ce que vous aimez et n’aimez pas après 1965 ?
Vous voulez que je téléphone à mon avocat? (Rires). C’est le moment de faire attention à ce que l’on dit… Ça dépend s’il faut répondre de manière objec¬tive ou subjective. D’une manière objective… ce que j’aime… le courage d’aborder des thèmes originaux, le courage de l’introspection… le courage de faire du cinéma diffé¬rent, d’avoir un langage person¬nel. Ce que je n’aime pas… C’est peut-être, parfois, un excès de nombrilisme. Sans doute aussi… cet aspect désenchanté, peu ludique, en ce qui concerne le Suisse romand en tout cas. Mais, enfin, c’est une question de goût tout à fait personnelle. Je préférerai toujours un Lubitsch ou la comédie musicale.
• L’esthétique est une science objective. Un art sans ludisme n’est pas de l’art.
(Rires). Je suis d’accord avec vous. (Rires). Le reproche qu’on pourrait faire souvent – je ne dis pas toujours – c’est que ce n’est pas un cinéma qui semble avoir été fabriqué dans le plaisir et pour le plaisir. Plaisir dans le sens le plus grand, pas plaisir dans le sens où ça arrange tout le monde, loin delà. Mais…
• Le sur-moi protestant…
Exactement. Fondamentalement. C’est ce protestantisme envahissant et assommant qui, personnellement, me rebute le plus. Ceci dit, je suis en train d’organiser une semaine de cinéma suisse pour mes élèves du gymnase et j’y montre Le Milieu du monde que je trouve très fort, qui pour moi est peut-être ce que Tanner a fait de mieux même si, peut-être, il n’est pas partout conséquent, qu’il ne va pas jusqu’au bout de ses propos. Voilà un film où il y a à la fois un début d’analyse sérieuse d’une situation socio-politique mais aussi psychologique, et puis une dimension poétique, avec les défauts de Tanner, à savoir cette volonté de distanciation qui n’en est pas une vraiment.
• Je n’ai vu que le malaise d’Olympia Carlisi dans les scènes de nu.
Je vous avouerai très franchement qu’Olympia Carlisi est la raison première pour laquelle j’ai aimé ce film. Je trouve cette femme superbe et je voudrais la voir plus souvent dans tous les films suisses.
• Tanner la montre pas peignée. On ne peut pas leur faire entrer dans la tête que l’art ce n’est pas la réalité !
C’est l’optique de Tanner qui ne veut en aucun cas enjoliver, styliser. Peut-être qu’il ne peut pas et ne veut pas. Les deux choses sont intimement liées. Ça ne correspond simplement pas sa vision. Qu’on le lui reproche, ce n’est pas tout à fait juste. Il s’exprime. Une flamme dans mon cœurest un cas intéressant, son côté provocateur m’a enchanté. Mais enfin, j’admets que c’est un cinéma qui ne peut pas plaire à tout le monde. On ne va pas par¬ler de Godard, donc. Personnellement, le cinéaste avec lequel en Suisse, j’ai le plus d’attaches, ça reste de très très loin, Daniel Schmid. Voilà quelqu’un qui fait du cinéma comme je l’aime et comme j’en voudrais beaucoup plus en Suisse. Ceci dit, des gens comme Markus Imhoof, parfois Goretta aussi, La Dentellièreest assez subtil, L’invitation a des prémices très intéressant. Il y a des choses ! Un peu de fougue qui est loin de me déplaire.
• Nous ne sommes pas tellement rentré dans le détail de votre travail. L’érudition…
Le travail d’érudition, c’était surtout ça le gros boulot. On ne trouve pas les biographies dans les dictionnaires. Il faut trouver les gens, ou leurs héritiers, les enfants ou la police pour retrouver les dates de naissance, reconstituer les carrières. Il n’y a pas de mystère : il faut payer de sa personne. Pour ce qui est des films, ce ne fut pas un problème, dans la mesure où la Cinémathèque en conserve une grande partie. Ce qui était difficile en revanche, c’était de retrouver les histoires des productions. Retrouver, par exemple, les motivations des gens qui ont fait ces films. En suivre le cheminement de fabrication. On partait d’une idée, puis en raison de tel aléa ou de telle pression, le résultat devenait tout autre. C’est ce qui me semblait particulièrement intéressant. Se rendre compte à quel point la réalisation d’un film est sujette à des modifications permanentes de tout ordre, artistiques ou non. Ma spécialisation, aussi curieux que cela puisse paraître, ce n’est pas du tout le cinéma suisse, ce sont les cinémas américain et allemand. Ce sont mes grands dadas. Je me suis lancé dans le cinéma suisse un peu par défi, parce qu’il n’existait rien et, que vivant en Suisse, j’étais sur le terrain idéal pour faire ce type de recherches. Je crois que ce n’est pas exagéré de dire que c’est une recherche de détective, déjà pour retrouver les gens et ensuite vider leur galetas. Les semaines que j’ai passées à la Bibliothèque nationale ou dans les collections privées à l’étranger, à feuilleter les journaux, à chercher des indications… Il n’existe pas de collection de coupures de presse. Les collections de la Cinémathèque commencent à être à peu près complètes à partir des années 60. Les archives de la Praesens, qui a été fondée en 1924 ont été détruites. Il a fallu les reconstituer en allant voir les script-girls, les cameramen. Les producteurs et les metteurs en scène ne gardent généralement pas les choses. Ce sont les petits métiers autour qui accordent le plus d’importance à ces souvenirs, ils ont pu souvent me remettre des scénarios annotés, de la correspondance, des contrats qui me permettaient de dater, par exemple, les tournages. Je tenais absolument à pouvoir présenter ces films dans l’ordre chronologique, non pas de sortie, comme ça se fait dans les ouvrages de compilation strictement filmographique, mais selon la chronologie du tournage. Comment faire ? Ce n’est pas écrit au générique du film où le rôle des gens n’est même pas indiqué. Il fallait retrouver des articles sur le tournage. Ça a été très difficile. Des contrats ou de la correspon-dance, c’était du matériel de rêve. Ça permettait de voir toutes les difficultés auxquelles s’achoppaient les cinéastes. Les gens mentionnés dans mon livre et qui l’ont vu ont été très émus et enthousiastes, un peu abasourdis. Le couple de Roméo et Juliette au villageétait de la fête. A se voir en photo pleine page, ils en avaient les larmes aux yeux. Ils disaient : « Ça y est. Nous sommes éternisés dans ce livre ». C’était très émouvant. Souvent, les gens que je suis allé voir étaient plutôt aigris. Par conséquent, ils ont détruit beaucoup de choses parce qu’ils se sont dit : « De toute manière ça n’intéresse plus les jeunes, plus personne. Nous sommes complètement oubliés ».






