
USAGES.
Échange autour d’allegro par Patrick Conscience et Yves Tenret.
allegro, un chant sur la mature immaturité, accompagné d’un texte, émeute nihiliste est un texte qui fut publié dans le n°2 de 48/88 pendant l’hiver 1978.
En 1979, Véronique Goël en a fait un film.
Le texte complet figure sur Dérives
Et la bande son du film – remarquable ! – peut en être écoutée sur MNE.
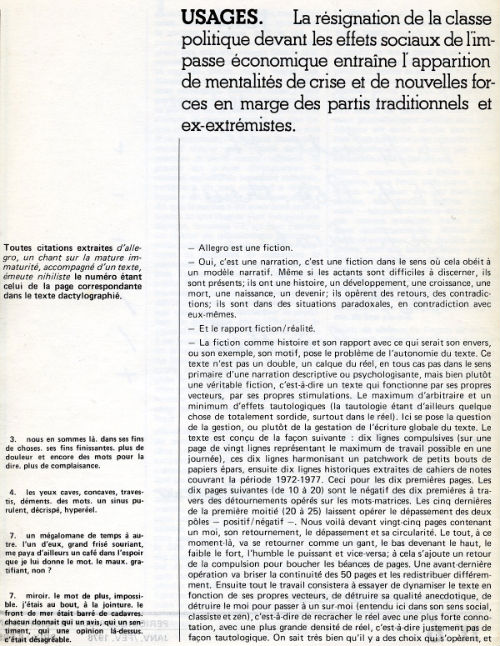
— allegro est une fiction ?
.
— Et le rapport fiction/réalité ?
— La fiction comme histoire et son rapport avec ce qui serait son envers, ou son exemple, son motif, pose le problème de l’autonomie du texte. Ce texte n’est pas un double, un calque du réel, en tous cas pas dans le sens primaire d’une narration descriptive ou psychologisante, mais bien plutôt une véritable fiction, c’est-à-dire un texte qui fonctionne par ses propres vecteurs, par ses propres stimulations. Le maximum d’arbitraire et un minimum d’effets tautologiques (la tautologie étant d’ailleurs quelque chose de totalement sordide, surtout dans le réel). Ici se pose la question de la gestion, ou plutôt de la gestation de l’écriture globale du texte. Le texte est conçu de la façon suivante : dix lignes compulsives (sur une page de vingt lignes représentant le maximum de travail possible en une journée), ces dix lignes harmonisant un patchwork de petits bouts de papiers épars, ensuite dix lignes historiques extraites de cahiers de notes couvrant la période 1972-1977. Ceci pour les dix premières pages. Les dix pages suivantes (de 10 à 20) sont le négatif des dix premières à travers des détournements opérés sur les mots-matrices. Les cinq dernières de la première moitié (20 à 25) laissent opérer le dépassement des deux pôles — positif/négatif —. Nous voilà devant vingt-cinq pages contenant un moi, son retournement, le dépassement et sa circularité. Le tout, à ce moment-là, va se retourner comme un gant, le bas devenant le haut, le faible le fort, l’humble le puissant et vice-versa; à cela s’ajoute un retour de la compulsion pour boucher les béances de pages. Une avant-dernière opération va briser la continuité des 50 pages et les redistribuer différemment. Ensuite tout le travail consistera à essayer de dynamiser le texte en fonction de ses propres vecteurs, de détruire sa qualité anecdotique, de détruire le moi pour passer à un sur-moi (entendu ici dans son sens social, classiste et zen), c’est-à-dire de recracher le réel avec une plus forte connotation, avec une plus grande densité de réel, c’est-à-dire justement pas de façon tautologique. On sait très bien qu’il y a des choix qui s’opèrent, et tout le travail consiste à essayer de casser ce qu’il y a d’individuel dans ces choix en réinstaurant l’arbitraire.
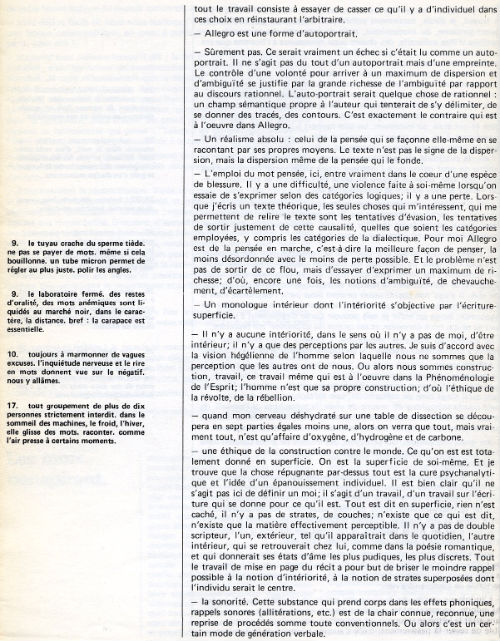
— allegro est une forme d’autoportrait ?
— Sûrement pas. Ce serait vraiment un échec si c’était lu comme un autoportrait. Il ne s’agit pas du tout d’un autoportrait mais d’une empreinte. Le contrôle d’une volonté pour arriver à un maximum de dispersion et d’ambiguïté se justifie par la grande richesse de l’ambiguïté par rapport au discours rationnel. L’autoportrait serait quelque chose de rationnel : un champ sémantique propre à l’auteur qui tenterait de s’y délimiter, de se donner des tracés, des contours. C’est exactement le contraire qui est à l’œuvre dans allegro.
— Un réalisme absolu : celui de la pensée qui se façonne elle-même en se racontant par ses propres moyens. Le texte n’est pas le signe de la dispersion, mais la dispersion même de la pensée qui le fonde.
— L’emploi du mot pensé, ici, entre vraiment dans le cœur d’une espèce de blessure. Il y a une difficulté, une violence faite à soi-même lorsqu’on essaie de s’exprimer selon des catégories logiques ; il y a une perte. Lorsque j’écris un texte théorique, les seules choses qui m’intéressent, qui me permettent de relire le texte sont les tentatives d’évasion, les tentatives de sortir justement de cette causalité, quelles que soient les catégories employées, y compris les catégories de la dialectique. Pour moi allegro est de la pensée en marche, c’est-à-dire la meilleure façon de penser, la moins désordonnée avec le moins de perte possible. Et le problème n’est pas de sortir de ce flou, mais d’essayer d’exprimer un maximum de richesse; d’où, encore une fois, les notions d’ambiguïté, de chevauchement, d’écartèlement.
— Un monologue intérieur dont l’intériorité s’objective par l’écriture-superficie.
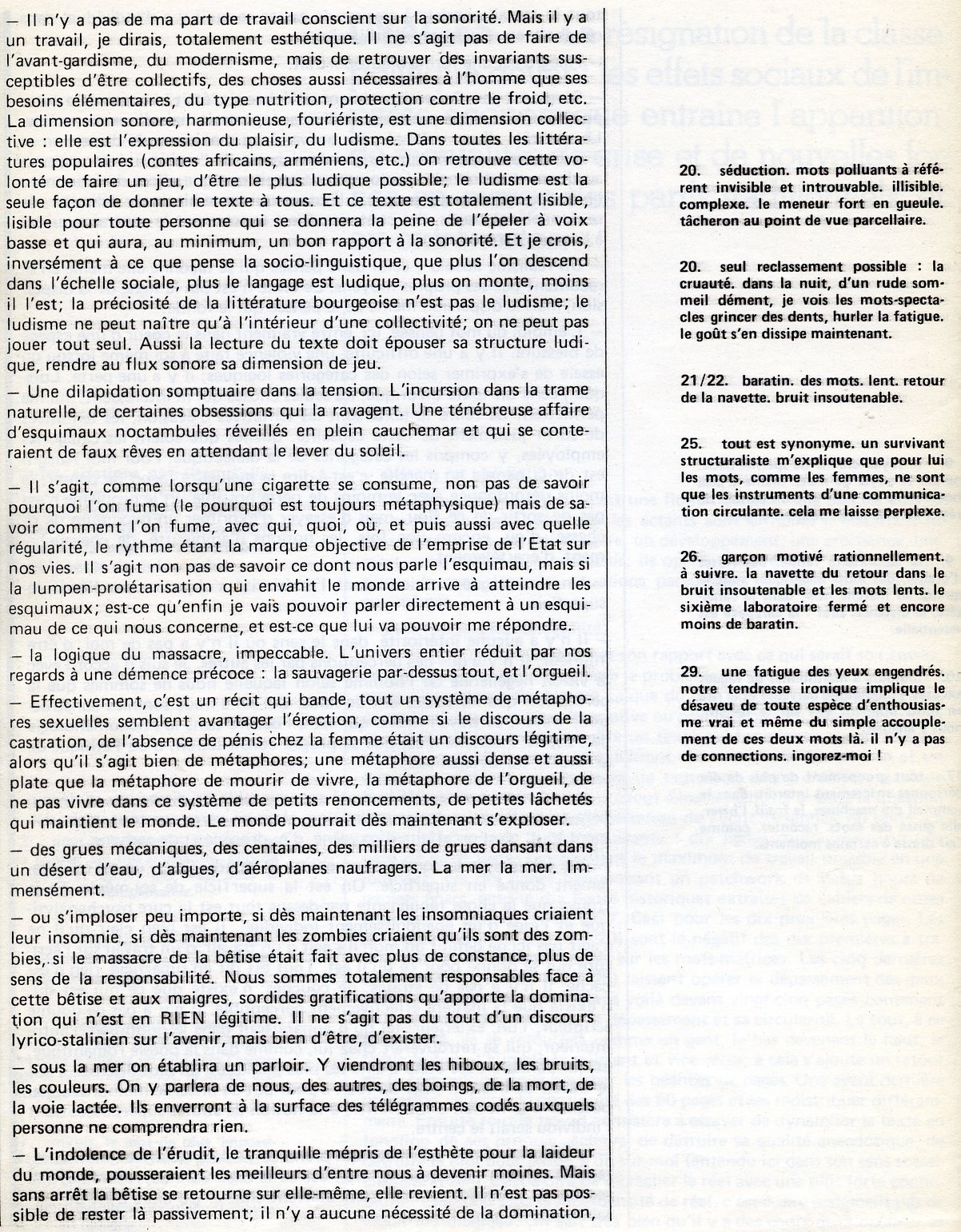
— Il n’y a aucune intériorité, dans le sens où il n’y a pas de moi, d’être intérieur ; il n’y a que des perceptions par les autres. Je suis d’accord avec la vision hégélienne de l’homme selon laquelle nous ne sommes que la perception que les autres ont de nous. Ou alors nous sommes construction, travail, ce travail même qui est à l’oeuvre dans la Phénoménologie de l’Esprit; l’homme n’est que sa propre construction ; d’où l’éthique de la révolte, de la rébellion.
— Quand mon cerveau déshydraté sur une table de dissection se découpera en sept parties égales moins une, alors on verra que tout, mais vraiment tout, n’est qu’affaire d’oxygène, d’hydrogène et de carbone.
— Une éthique de la construction contre le monde. Ce qu’on est, est totalement donné en superficie. On est la superficie de soi-même. Et je trouve que la chose répugnante par-dessus tout est la cure psychanalytique et l’idée d’un épanouissement individuel. Il est bien clair qu’il ne s’agit pas ici de définir un moi ; il s’agit d’un travail, d’un travail sur l’écriture qui se donne pour ce qu’il est. Tout est dit en superficie, rien n’est caché, il n’y a pas de strates, de couches; n’existe que ce qui est dit, n’existe que la matière effectivement perceptible. Il n’y a pas de double scripteur, l’un, extérieur, tel qu’il apparaîtrait dans le quotidien, l’autre intérieur, qui se retrouverait chez lui, comme dans la poésie romantique, et qui donnerait ses états d’âme les plus pudiques, les plus discrets. Tout le travail de mise en page du récit a pour but de briser le moindre rappel possible à la notion d’intériorité, à la notion de strates superposées dont l’individu serait le centre.
— La sonorité. Cette substance qui prend corps dans les effets phoniques, rappels sonores (allitérations, etc.) est de la chair connue, reconnue, une reprise de procédés somme toute conventionnels. Ou alors c’est un certain mode de génération verbale.
— Il n’y a pas de ma part de travail conscient sur la sonorité. Mais il y a un travail, je dirais, totalement esthétique. Il ne s’agit pas de faire de l’avant-gardisme, du modernisme, mais de retrouver des invariants susceptibles d’être collectifs, des choses aussi nécessaires à l’homme que ses besoins élémentaires, du type nutrition, protection contre le froid, etc. La dimension sonore, harmonieuse, fouriériste, est une dimension collective : elle est l’expression du plaisir, du ludisme. Dans toutes les littératures populaires (contes africains, arméniens, etc.) on retrouve cette volonté de faire un jeu, d’être le plus ludique possible ; le ludisme est la seule façon de donner le texte à tous. Et ce texte est totalement lisible, lisible pour toute personne qui se donnera la peine de l’épeler à voix basse et qui aura, au minimum, un bon rapporta la sonorité. Et je crois, inversement à ce que pense la sociolinguistique, que plus l’on descend dans l’échelle sociale, plus le langage est ludique, plus on monte, moins il l’est ; la préciosité de la littérature bourgeoise n’est pas le ludisme ; le ludisme ne peut naître qu’à l’intérieur d’une collectivité ; on ne peut pas jouer tout seul. Aussi la lecture du texte doit épouser sa structure ludique, rendre au flux sonore sa dimension de jeu.
— Une dilapidation somptuaire dans la tension. L’incursion dans la trame naturelle, de certaines obsessions qui la ravagent. Une ténébreuse affaire d’esquimaux noctambules réveillés en plein cauchemar et qui se conteraient de faux rêves en attendant le lever du soleil.
— Il s’agit, comme lorsqu’une cigarette se consume, non pas de savoir pourquoi l’on fume (le pourquoi est toujours métaphysique) mais de savoir comment l’on fume, avec qui, quoi, où, et puis aussi avec quelle régularité, le rythme étant la marque objective de l’emprise de l’Etat sur nos vies. Il s’agit non pas de savoir ce dont nous parle l’esquimau, mais si la lumpen-prolétarisation qui envahit le monde arrive à atteindre les esquimaux ; est-ce qu’enfin je vais pouvoir parler directement à un esquimau de ce qui nous concerne, et est-ce que lui va pouvoir me répondre.
— La logique du massacre, impeccable. L’univers entier réduit par nos regards à une démence précoce : la sauvagerie par-dessus tout, et l’orgueil.
— Effectivement, c’est un récit qui bande, tout un système de métaphores sexuelles semblent avantager l’érection, comme si le discours de la castration, de l’absence de pénis chez la femme était un discours légitime, alors qu’il s’agit bien de métaphores; une métaphore aussi dense et aussi plate que la métaphore de mourir de vivre, la métaphore de l’orgueil, de ne pas vivre dans ce système de petits renoncements, de petites lâchetés qui maintient le monde. Le monde pourrait dès maintenant s’exploser.
— Des grues mécaniques, des centaines, des milliers de grues dansant dans un désert d’eau, d’algues, d’aéroplanes naufragés. La mer la mer. Immensément.
— Ou s’imploser peu importe, si dès maintenant, les insomniaques criaient leur insomnie, si dès maintenant, les zombies criaient qu’ils sont des zombies,, si le massacre de la bêtise était fait avec plus de constance, plus de sens de la responsabilité. Nous sommes totalement responsables face à cette bêtise et aux maigres, sordides gratifications qu’apporte la domination qui n’est en RIEN légitime. Il ne s’agit pas du tout d’un discours lyrico-stalinien sur l’avenir, mais bien d’être, d’exister.
— Sous la mer on établira un parloir. Y viendront les hiboux, les bruits, les couleurs. On y parlera de nous, des autres, des Boeings, de la mort, de la voie lactée. Ils enverront à la surface des télégrammes codés auxquels personne ne comprendra rien.
— L’indolence de l’érudit, le tranquille mépris de l’esthète pour la laideur du monde, pousseraient les meilleurs d’entre nous à devenir moines. Mais sans arrêt la bêtise se retourne sur elle-même, elle revient. Il n’est pas possible de rester là passivement; il n’y a aucune nécessité de la domination.
— Alors déjà la foule où nous nous hurlons ; j’y invente, et nous, sur place, une langue catastrophique, en crue, à perte de sens, de transmissible, à perte, pour rire !
— De cette fausse logique du monde rationnel. Je suis entièrement d’accord avec Adorno lorsqu’il dit : le fin du fin, le plus pur de la rationalité, c’est les camps de concentration. Je ne crois pas à cette rationalité. Je crois effectivement que la dépense, la gratuité sont des modes à être totalement humain. Il ne s’agit pas ici d’humanisme, l’humanisme est vague, fait d’invariants, qui figent le monde, le glacent d’ennui. Le problème serait de ne pas tomber, corporellement et mentalement dans le parcellaire, mais d’avoir un point de vue global, de ne pas être comme ce bureaucrate qui pense : « laissons les bureaucrates gouverner l’Etat, et donnons une large autonomie à la base » (et qui dit le contraire).
— Somme toute quoi de plus harassant que l’inachevé, de plus dense. Adieu, donc, mes petits copains les coupeurs de têtes tièdes s’impatientent.
— Effectivement la réconciliation. Voilà ce à quoi a servi l’art ; l’art a servi à panser les blessures des dominants, et, jusqu’à présent, uniquement à légitimer leur domination. Ils disent : regardez ce que nous faisons, nous faisons des choses belles. D’accord, d’accord nous brimons, nous brimons les trois quarts de l’humanité mais nous faisons des choses belles. Et puis nous souffrons, nous avons une âme, nous sommes comme vous. Non, ils ne sont pas comme nous. Oui je suis pour leur élimination physique la plus radicale possible afin d’extraire la racine. Oui je comprends les révolutionnaires indiens qui lorsqu’ils pénétraient dans une riche propriété tuaient non seulement le propriétaire et sa femme, mais aussi ses enfants et les domestiques.
— Oui, très mal ; ils viennent quatre fois la nuit dans nos cellules, avec des lampes de poches, pour voir si nous dormons; tout cela va très mal finir.
— Ni maîtres ni larbins ! Je ne suis ni romantique ni fou. Les fous, ce sont les agents de l’Etat et leur incroyable dépense productrice de brimades, leur rationalité d’une vie sans vie. Bon d’accord, je suis romantique et fou, mais jusqu’au vice, de façon perverse, passionnelle.
— Artaud : la vie est de brûler des questions.
Patrick Conscience — Yves Tenret.











