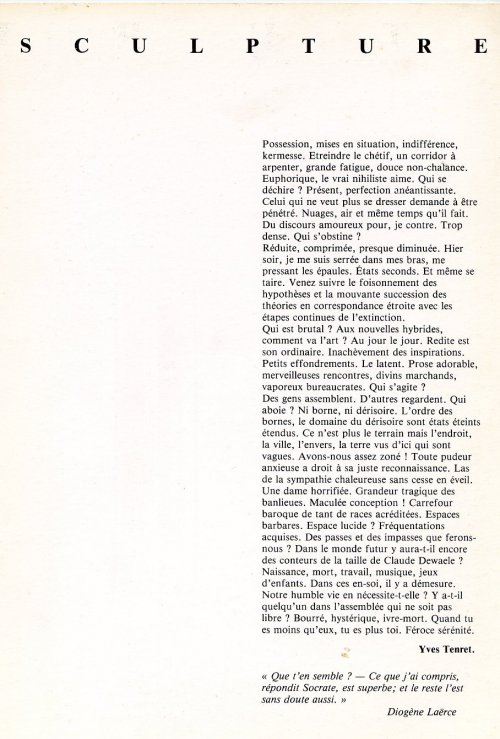
SCULPTURES.
Cette exposition est exemplaire. Tout un vocabulaire se renouvelle, se vérifie, s’essaye, s’installe. D’anciennes expériences sont amenées à maturité. Des matériaux s’émancipent. La sculpture a été conceptualisée, minimalisée, allégée. C’est intégré. On démontre. On détourne, on marque, on installe, on intervient, on voile, on dévoile, on capture, on assemble, on intensifie, on déconstruit, on ancre. On retourne à des figures abandonnées. On questionne beaucoup. On prouve, approuve, désapprouve. Briser, casser, évoquer à voix douce est nommé : « dispositif ». On réduit, on déduit, on échafaude. On insiste sur le respect dû au matériau. Animisme ? Nostalgie artisanale ? Modestie ? Rituel au sens perdu ? La sculpture d’angle est un totem rationaliste. Net retour au dessin et franche suspicion envers le « spontané ». Le récit est plus élaboré. Une nouvelle fiction ? D’autres prières, d’autres actions de grâce, d’autres deuils. Pierre, autel, monument. La créativité n’est plus identifiée à l’inculture. Pas d’instinct, pas de violence. La constipation dogmatique est passée. Temps de crise. Ça dégraisse. L’archaïsme n’est pas à Vanatu mais dans le bon goût des années 50-60, le long des autoroutes et dans les villes nouvelles. Cette exposition est risquée. Travail en train de se faire. Pas un problème de transport, d’assurance, de gardiennage, de muséologie. Un rythme cardiaque. Et si c’était mort-né, naze, bidon, gebour, lopro, kaput, raté ? Le « brut » jamais ne sauve. Eau de pluie, seaux de plastique, huttes, nanars, gage lointain, anamorphose, lumière grise, fleurs obscènes, sens unique, goudron, make-up de bleu ardoise sur étoiles d’argent, sirocco, harmattan, trous, pelle mécanique, tassement, poutrelles couchées, branches coupées, verre pillé. Ils diront : Vas-y, donne, donne, donne ! Le bien, le bon, le vrai sur une vague molle. Pathos, mièvrerie, bavardage. Qu’est-ce qui revient ? A tous le Lego est commun. Cette exposition est vulnérable.
Le questionnement. « … si le spectateur veut voir tous les détails, il doit se tordre dans des positions diverses ». (Alkema.) Signal ! Danger ! Fermez les yeux, des oreilles vous regardent. Les passages, les abris, les points d’ancrage. Pas de sédiments affectifs. Assemblage. Ce sont forme, texture, matérialité, signalisation, code qui tracassent. Poids et non-poids. L’apesanteur : Moloch, vertige, préciosité. C’est discursif, graphique, analytique. Branche/poutre non pas comme nature/culture mais comme prolifération anarchique/matériaux calibrés. S’évacue la diachronie, se marque l’espace, se rompt le frontal. Serait aimé que l’on pénètre un instant, pour y vivre « dangereusement », en les œuvres. Ce n’est pas en plus grand ce qui à l’habitude serait petit. « Marquer un espace est déjà le déconstruire ». (M. Borse.) Ni ineffable, ni sacral, ni totémisme. Tintin, à la veillée, prend sa guitare et accompagné d’un choeur de girl-scouts chantonne sur l’assaut à jamais jamais final. Invite au regardeur, offre d’une part dynamique, appel à la réflexion, au jeu organisé, à l’activité consciente. Pas de risque de sclérose. Seulement de bavardage. De plus, pas tout d’une pièce. Le fer est dit agressif, la tige métallique, souple et les matériaux potentiellement rituels. « Ces matériaux peuvent faire mal mais c’est eux qu’on choisit toujours ». (Borse.) Hasard, devenir prédéterminé et intervention consciente se rencontrent, causent ensemble, s’échauffent mutuellement. Qui reste de marbre ? S’être donné les moyens de remettre en question le pillier « Untel » a toujours été l’une des voies possibles. Les moyens sont là. Wait and see. Pas de sarcasme. Pas le moindre petit rire. L’heure est-elle grave ?
La disparition – M.-P. Roubin. « … ce travail apparaît comme très mystique. C’est une réflexion cosmologique ». (N. Prête.) Plus de biscuits. Poudre de terre, argile cuite, consistance farineuse. Durable et éphémère sont clichés. Loin de la cérémonie. Arts « primitifs » et sur-moi. S’en inversent les termes de la formule fameuse de Jean-Michel Yoyotte : « Les arts primitifs n’existent pas. Ils sont un moment de l’art moderne ». En un souffle se dissout le cuit, se chevauche le vent, s’en connaît les noms, les petits et les secrets. Aucune discrétion car n’est discret que le fonctionnel. Céramique évanescente. Installation en aperception profonde du lieu. Séries, répétitions, variations. « Le geste qui répète agit à la fois comme dévalorisation et intensification ». (J.-L. Cornilleau.) Formes, couleurs, emplacements. « C’est la plus joueuse et la plus gaie des baleines, elle soulève une écume plus pétillante et plus blanche que les autres cétacés ». (H. Melville.) Obsession, identité, territorialisation. C’est Moi qui répète. Ça bouge parce que Je ne suis pas figé. Art d’intentionnalité. Quelle est la mini catastrophe qui a entamé ses instables cônes de sable ? Never more. Bâtir, tisser, rêver dans un sommeil éprouvant du perdu à jamais. « L’on ne sait pas ce qu’est la distance ni ce qu’est le temps, nous savons seulement comment les mesurer ». (Alkema.) Combien sont-ils, les vivants dans les écoles d’art qui parlent contre le métier et pour les matières, contre les matières et pour le métier ? « Schizophrènes ». Carreleuses, céramistes, tapissières-, tailleuses de pierre, menuisières, mosaïstes, couturières qui crachent dans les rues piétonnières et sur la pavane muséale des objets défunts. « Cette époque n’a que faire des chambres fétides d’un romantique. Et c’est tant mieux ». (F. Pajak.) « Ce qui m’intéresse, c’est le déplacement ». (Borse.) « Je veux frustrer le spectateur ». (Y.-Y. Tchine.) « Ou bien, on rencontre un collaborateur, un ancien étudiant par exemple, sur un pont… « Quand est-ce qu’on fait quelque chose ? » Ce quelque chose c’est quoi ? Moi je veux l’outil, lui il veut que je fume la pipe et que je raconte la révolution hongroise ». (J. Urban.) « L’apprentissage des techniques se fait lui-même en dehors de toute perspective historique ». (F. Rappo.) « … il me semble aussi intéressant de montrer les éclats, les déchets de toutes sortes avec le résultat compact. La sculpture c’est le rapport entre cette forme ici et les déchets là ». (Alkema). On entre dans la paire « tout-laisser-perdre/ne-rien-laisser-perdre ». Bientôt… Regrets. L’oeuvre est l’événement d’« une vie d’artiste ». Et pourtant… La mer. Satisfaite insatisfaction. Holocauste. Rythme hagard. Chapelet monotone. Présence jubilatoire. Superficialité légère, stérilité pondérée, immaturité inventive. A bon entendeur…
La légende – J.-L. Ricur. « … j’ai toujours l’impression d’être tout nu comme le voleur, qui fait des petits coups en douce… » (B. Giner.) Un récit qui suggère puis s’interrompt. « La clôture ! La banlieue ! » (J.-L. Ricur). La qualité esthétique est donnée. Reste à faire naître la légende. J’ai toujours eu une grande affection pour les sentiers battus. Ça travaille aux limites artisans-artistes. Les murs. Ça n’hésite pas à raconter l’histoire. Et, il y en a une. L’esprit général. Qui cogite ? Et quoi ? Quand on se perd en rigide où est la « sortie de secours » ? On va chercher une brouette de terre, pas celle à lapin, mais une bonne glaise bien collante. Enfin ! Monte, démonte, assemble, mélange, couvre, cimente, colore. L’ardoise est tellement belle en elle-même qu’on a envie de s’asseoir sur terre et d’attendre que ça passe. Mes œuvres, que vont-elles faire de moi, semble-t-il penser. Poussière, tu es etc. Ardoises dressées autour d’un trou en un fouillis inextricable de branchage deviendrez-vous cet objet volant non identifié que je cherche chaque soir dans le bleu nuit claire de mes yeux caves ?
_
L’évocation est profonde, très investie, intense. Tombes, cabanes, pieux. Lieux secrets. Toutes nos petites terreurs. Aussi les petites joies qui n’existent que d’être connues de nous seul. On ne peut confondre la bise, la statue d’un philosophe et un bunker abandonné. Je ne sais pourquoi, je vois un homme armé d’un seul drapeau noir. « Qu’il fut l’extrême précarité à l’entreprise à cette extrémité même pointait la possible liberté qui n’est point préoccupation ». (P. Tal-Coat.) L’ardoise est-elle un matériau friable ?
La lumière – E. Saulnier. « Il apparaît dans la pénombre, nu près du piano qu’il caresse et lèche. Ensuite il lit un texte… » (Ben.) Variations. Pour le meilleur et pour le pire. Lignes-masses-couleurs. Le lieu comme outil de travail. Les arbres qui se découpent à l’horizon, le château d’eau, l’élévation. Sanctus domine… Echelle de Jacob, buisson ardent, Golgotha. Trois croix. La stupeur devant le lieu. Puis ça se remet en marche d’un « Que suis-je ? » Lumière, tube de verre empli d’eau, fil d’or, cylindre de verre, disque de verre, plaque de verre, source, dalle de verre, eau de pluie. Je suis ruissellement. Trois torsades de plomb ruissèleront d’or. La réalité conditionne la forme. Poids, résistance, etc. Toute la réalité : la pièce est périssable. Hanoukka. L’œuvre est réconciliée. Attachée à sa propre transformation, elle épouse le temps qui s’écoule. L’or va dépérir, s’effeuiller, disparaître. Le plomb : élément de masse type. L’or : matière sensible, conductrice de lumière et infiniment maniérée. Trois lignes, double triangle de la vue, un losange, une droite centrale et dominante. Ça va du « point de vue » à la perte de vue en élévation dans le maximum, en cet endroit offert, de perspective possible. Tonnerre lent, foudre calme, éclair d’or. Mouvement léger de transparence, zigzag en treillis sur matière dense, rideau feuillu. L’élément plastique est la ligne. Le tic verbal est : « Tu vois ? » Giclée de miel, bière ambrée, vermisseaux lyriques. Toutes les matières sont utilisables à qui se veut directement sculptural dans la nature. Et la ville lumière ? Le nombre de structures qu’il était, est devenu fin en soi. Tout s’implique. Les formes remplacent si mal les mots… Pour le sourd, la musique n’est ni bonne ni mauvaise. « Elle ôta un instant son gant, soit pour toucher ma main, soit pour m’éblouir en me laissant voir à son petit doigt, …. une bague où s’étendait la large et liquide nappe d’une claire feuille de rubis :
_
« Encore une nouvelle bague, Albertine. Votre tante est d’une générosité ! — Non, celle-là ce n’est pas ma tante, dit-elle en riant ». (M. Proust.)
Le hurlement – F. Limérat. « Parler pour parler est la seule délivrance ». (Novalis.) D’avoir toujours été loué et loué comme discret, silencieux, pervers s’en est arrivé là. Contre caractériel. C’est braillard et vociférant. Ni minutieux ni grandiloquent. Appliqué à se faire, à avancer, à oser. L’anecdote en son universalité patente règne. Ça finira peut-être en fouillis. Au départ, c’était entre le châssis pour lui-même, des allumettes et l’extraordinaire aventure minimaliste. Le développement est têtu. Cela se connut très tôt comme refus du criblage didactique et comme désir d’accouplement avec la rusticité, le néo-archaïsme et le « primitif ». Ça a évoqué de suite la sensibilité. Ça s’est affermi. Aucune panique. La main ne perturbe rien. Hors-jeu. Coup de sifflet. Silence ! La couleur vient attendrir. Arrive l’objet-peinture. Contorsion lisible. Gesticulation transparente. J’ai la bouche pleine ? Oui. Castor ivre, jazzman blanc, indigène. C’est la maturité, le moment de la faconde heureuse, le positif. Confus, cela reste clair. Le travail a disparu. Tout est nommable. Le secret est une pose. « Et qu’on ne vienne pas me dire : Sois plus souple ! J’éclaire la femme par l’agonie ». (Y. Nilkorian.)
L’anamorphose – T. Alkema. Casse sur du granit des outils très chers. Il articule. Il gambade. La franchise d’un rire. L’exception. Le discours sur le vide est aussi beau que Gisèle Vichnou… Une matière, un emploi, un lieu. Se coltine la durée. « Mais c’est le déplacement de la caméra qui enregistre cet endroit et la façon dont elle l’enregistre devient plus importante, plus visible que l’endroit lui-même. Peu importe l’endroit c’est le travail de prise de vue qui est visible ». (Alkema.) Du conceptuel, en contact photos n° 23, 24, etc., le mouvement de la vague, un trou dans les pavés. Atelier supprimé. On travaille dans la rue. Huit déplacements, endroits précis où le soleil apparaît de face entre deux façades à heures précises. How it’s to feel like une pierre qui ne roule pas ? La distance s’insiste. Qu’est-ce qu’un carrefour ? Le mot ICI là-bas et ailleurs. « C’était toujours bon ». (Alkema.) L’axe de face devenant de profil, la profondeur, horizontalité et par exemple : à l’extérieur sur le trottoir (photos collées), on peut voir ce qu’on voit du trottoir de l’intérieur. Des panoramas. Des fenêtres.
_
« Tu fais n’importe comment et ça marche. De loin c’est abstrait, de près une réalité sociale. J’ai fait un planétarium pour la classe ouvrière chez un serrurier qui s’en foutait complètement. C’était merveilleux. Une ampoule à changer tous les quinze jours ». Après retour aux ciments — formation : tailleurs de pierres —, au dessin aux gris, aux blancs, au bois de coffrage. Belles à lécher. Dix kilos de cire d’abeille, du plâtre, un tube d’acier, une spirale sol-plafond, un disque. We all love rock-and-roll. Disque d’or donc. Première anamorphose sol-mur. De vrais escaliers mis à plat à côté d’utiles faux escaliers. Des pièces coulées accrochées dans des sangles qui peuvent se dérouler, se rassembler, se démontrer. Toujours et depuis longtemps, une importante phase de préparation. Toutes les dimensions sont réutilisées. Sculpture rotative, chiffrée, montée sur roulettes. Espèces sonnantes et trébuchantes. Rien qu’à prononcer « à fresque », il s’émeut. Pas de typique tepee. Avec le matériau qui a typiquement des angles droits, on fait une œuvre sans angle droit. Bon… Et l’anamorphose ? Est-ce la détermination d’un itinéraire ? Ces « bizarreries » ont été au XVIe siècle l’une des premières manifestations d’une recherche artistique dont l’objet, la finalité était l’art lui-même. Entre panier de crabes et dilettantisme égrillard, un sans-faute.
Epoque & matières. Les deux et rien. « Tout critique est proprement une femme à l’âge critique, envieux et REFOULÉ ». (C. Pavèse.) Autant pour moi. « Le corcor ! Tapette ! J’achète ». (Limérat.) « L’appareil photo devient la vraie sculpture. Ce n’est pas la pièce qui modifie l’espace mais l’appareil comme moyen d’enregistrer cette modification ». (Alkema.) Des objets monumentaux peuvent être d’aériens symboles condensés. Si la mère s’inquiète, les pères sévères. Tatline, Lissitzky, Schwitters. «… acharné je commence les autoportraits acharnés ». (B. Dufour.) Le chic aujourd’hui est d’affirmer, je fais n’importe quoi n’importe comment. Irrégulier. Lacunaire. « Naïf ». Elliptique pour les meilleurs. « Par l’organisation très stricte de son travail, c’est l’organisation générale du monde que Roubin questionne ». (N. Prête.) Ah bon ? « Tout l’hiver suivant, je patinais et j’obtenais plusieurs médailles. Le printemps venu, je décidais de devenir artiste ». (Alkema.) Frères humains qui après nous…
_
Certains soirs, la rive gauche est bloquée par l’empreinte, la trace et autres fragments. Nous sommes invités à la reconceptualisation. On déterritorialise. On nomadise. Serions-nous transitoires ? « Analyse critique, théorie, production, de ces trois piliers de l’avant-garde les deux premiers s’écroulent ». (R. Pons.) Et le troisième, comme pour satisfaire l’un de mes plus chers caprices, est bien malade. Les militaires de l’art vont peut-être disparaître ? « … l’angoisse croît de ne plus trouver de pensée suffisamment solide pour faire front à ce sentiment d’impasse ». (R. Pons.) Plus de maître à penser… Par Odin ! Je jouis. La Station-Gaité, la trombe hydropneumatique arrive. Tirez !
_
De toutes les performances, ce sont les publicitaires que je préfère. Les derniers groupies s’interpellent d’un « mouvance ». Micro et macro vont en bateau. Le « graphe » toujours est qualifié de « singulier ».
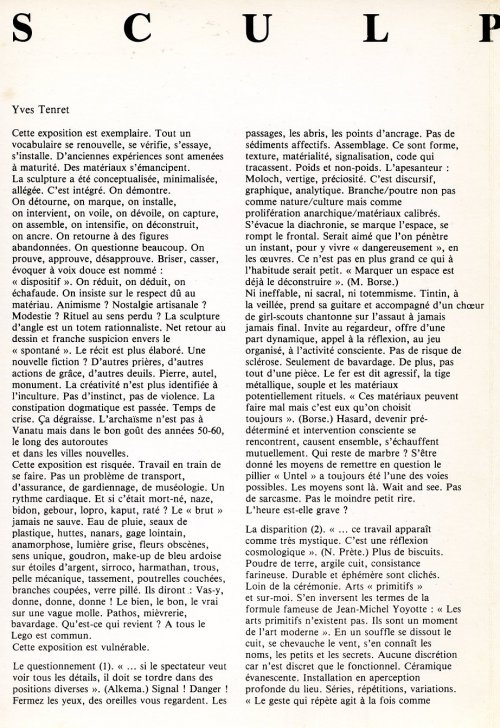
SCULPTURE.
Possession, mises en situation, indifférence, kermesse. Etreindre le chétif, un corridor à arpenter, grande fatigue, douce nonchalance. Euphorique, le nihiliste. Qui se déchire ? Présent, perfection anéantissante. Celui qui ne veut plus se dresser demande à être pénétré. Nuages, air et même temps qu’il fait. Du discours amoureux pour, je contre. Trop dense. Qui s’obstine ?
Réduite, comprimée, presque diminuée. Hier soir, je me suis serrée dans mes bras, me pressant les épaules. États seconds. Et même se taire. Venez suivre le foisonnement des hypothèses et la mouvante succession des théories en correspondance étroite avec les étapes continues de l’extinction. Qui est brutal ? Aux nouvelles hybrides, comment va l’art ? Au jour le jour. Redite est son ordinaire. Inachèvement des inspirations. Petits effondrements. Le latent. Prose adorable, merveilleuses rencontres, divins marchands, vaporeux bureaucrates. Qui s’agite ? Des gens assemblent. D’autres regardent. Qui aboie ? Ni borne, ni dérisoire. L’ordre des bornes, le domaine du dérisoire sont états éteints étendus. Ce n’est plus le terrain mais l’endroit, la ville, l’envers, la terre vus d’ici qui sont vagues. Avons-nous assez zone ! Toute pudeur anxieuse a droit à sa juste reconnaissance. Las de la sympathie chaleureuse sans cesse en éveil. Une dame horrifiée. Grandeur tragique des banlieues. Maculée conception ! Carrefour baroque de tant de races accréditées. Espaces barbares. Espace lucide ? Fréquentations acquises. Des passes et des impasses que ferons-nous ? Dans le monde futur y aura-t-il encore des conteurs de la taille de Claude Dewaele ? Naissance, mort, travail, musique, jeux d’enfants. Dans ces en-soi, il y a démesure. Notre humble vie en nécessite-t-elle ? Y a-t-il quelqu’un dans l’assemblée qui ne soit pas libre ? Bourré, hystérique, ivre-mort. Quand tu es moins qu’eux, tu es plus toi. Féroce sérénité.
Yves Tenret.
« Que t’en semble ? — Ce que j’ai compris, répondit Socrate, est superbe; et le reste l’est sans doute aussi. » Diogène Laërce
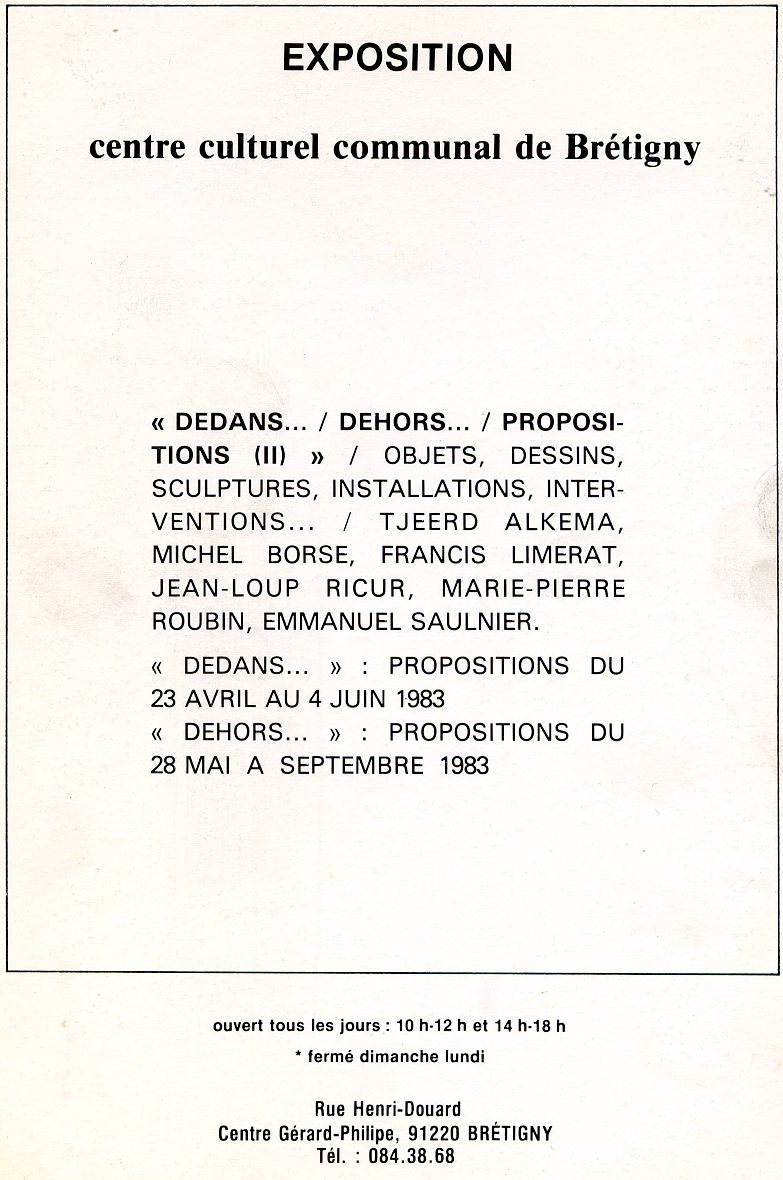
ENTRETIENS.
Goud heefl meer kracht dan vele woorden. Et ta sœur ! Tjeerd Alkema.
Quand est-ce que je refuse une exposition ? J’en refuse. Il faut que ce soit une aventure. Egocentriquement parlant, il faut que j’y apprenne quelque chose. Et si j’apprends, les autres peuvent aussi apprendre. Je refuse les accrochages. C’est curieux. Pour les peintres, c’est facile. Ils accrochent tout en une demi-heure. Leur seul problème, c’est que la plupart oublient d’apporter des clous et qu’ils passent donc leur temps à cher¬cher des clous et un marteau.
J’ai fait des choses à l’extérieur, des interventions cachées, des essais dans la nature qui étaient photographiés après. Ça correspondait, un petit peu, aux bornes des randonneurs. Ça disait : « Un être humain est passé par là. » C’est du marquage. Je n’ai jamais exposé ces photos car cela aurait été à nouveau du pictural. Il n’y a pas de problème intérieur/extérieur, même au niveau monumental. Je fais, en ce moment, un projet pour une salle de Toulouse qui a 45 mètres de long ! Une pièce de 30 mètres… Mais c’est quand même rare qu’on puisse travailler à l’extérieur. Brétigny, c’est bien…
Côté matière, je récupère. Ici, les briques creuses de O’Loughlin parce que ça coûte beaucoup moins cher et que ça n’a aucune importance. Dans son texte, elle dit : « Le matériau n’est pas très important. » Je le pense moins mais ces briques iront très bien avec la pelouse. Je les prends parce qu’elles font partie du lieu, parce qu’elles ont été là pendant une année. Elles font partie du risque. On va voir ! Elles seront toutes meulées. Il n’y aura aucun angle droit là-dedans. Je vais me casser la tête. On va voir… Je suis, un sculpteur plat, implosé.
Il y a trois matériaux. Ici, la brique creuse très intéressante parce qu’on est face à une échelle importante. J’aurai pu le faire en plâtre parce que c’est le matériau que je préfère. Le plâtre est blanc, commun. C’est drôle à faire, rapide. On peut le casser. Il laisse des traces. Mais à l’extérieur, cela s’oxyde trop vite, ça ne reste pas, ça se salit. Je ne travaille pas avec du poids. C’est une sorte de dessin dans l’espace. Ce sont des traces dans le paysage et dans le sol. Mon truc c’est : « Si tu veux voir la chose totalement, déplace-toi ! » Le côte anamorphose, c’est ça aussi. Un point rassemble ce qui se disperse dans l’espace. Tu tournes autour, la dispersion recommence. Le troisième matériau, c’est le ciment. Le bois de coffrage aussi. Je ne teinte pas le ciment. Ce serait trop sophistiqué. Le ciment est beau en soi.
J’accroche mes pièces au mur de façon invisible. Elles sont collées au mur. Certains les appellent « soucoupes volantes », « ovni » et des choses comme ça alors que pour moi, tra-vailler avec du ciment, c’est montrer ce qu’il y a à l’intérieur du mur.
Ma première anamorphose avait commencé comme un gag. J’avais fait un disque, « Le sillage d’une spirale centripète en déplaçant un tube d’acier accordé en sol, au plafond ». Après, on a essayé de trouver un certain nombre de jeux de mots : on va lancer le disque, etc. En même temps, dans la galerie, il y avait un mur à remettre en état. Je voulais, depuis très longtemps, travailler dans un mur. Alors, j’ai décidé de faire un disque d’or. Ça m’a pris du temps. Ce n’était pas si évident que ça. Le doré ne marchait pas, je voulais enlever assez du mur, je ne voulais pas en enlever trop, etc. Je voulais coller le sol au mur tout en attaquant le mur. C’est risqué parce que tu ne sais pas à l’avance ce qu’il y a dedans. Ce peut être de très vieux murs. Tu travailles par rapport à la mémoire du mur. Il faut doser les choses. Je me suis retrouvé ensuite complètement dépasser, ne sachant plus que faire. Je me suis remis à dessiner.
En octobre de l’année dernière, j’ai fait ma deuxième anamorphose. Je voulais aller plus loin, comprendre ce qui me troublait là-dedans. Je ne voulais pas la faire en doré, couleur devenue entre-temps à la mode. Je me rendais compte que c’était une solution parce que implosé, sculptural, ayant à faire avec le lieu et l’espace.
L’anamorphose, à la rigueur, je m’en fous. Je tourne autour du truc. Je veux qu’il joue de tous les côtés et il y a un endroit principal qu’il faut chercher. De toutes façons, je corrige tout à l’œil. Il y a une partie dessin à même le mur. On peut l’imaginer à l’aquarelle. Je l’ai fait jusqu’à présent à l’argenté ou au doré. Le doré, je peux plus. L’argenté, c’est bien. Tu le passes sur une brique, personne ne peut se tromper. Je l’utilise depuis 1970. C’était de la peinture pour tuyau de poêle. Je veux rester près des choses simples, de celles que l’on utilise dans la construction.
Un texte sur la sculpture peut être de tout. Il y a très peu de bons textes sur la sculpture. Les gens ont bien envie d’écrire sur l’espace psychologique, l’espace sociologique, l’espace politique, l’espace analytique, l’espace psychanalytique de la chose mais dès que tu t’attaques au côté sculptural de l’espace, il y a un physique qui échappe.
Etre « m’as-tu vu » est un problème de dimension. Quand tu fais une pièce transportable, tu as des dimensions qui sont « le portable ». Je joue parfois sur l’ambiguïté peinture/sculpture, vrai/faux. Pour aller au-delà, il faut travailler par rapport au lieu même. J’ai horreur des choses qui sont verticales. Le verticale, c’est le m’as-tu vu. Reste un problème d’échelle. En 1978, je faisais des pièces de 15 centimètres de haut et je les trouvais très grandes. Je me disais : « Où il y a quelque chose qui ne va pas avec ces trucs ou, c’est moi qui ait changé. » Je ne savais plus. En plus, je dessinais à la même dimension et dans mes dessins, cela donnait l’impression d’être encore plus grand. Problème d’échelle… Pendant deux ans, j’ai forcé avec ça… Trouver une échelle différente…
Je consomme beaucoup de musique, beaucoup de jazz, du jazz des années 40-80. C’est possible à Montpellier. Nous faisons un programme de jazz à Radio Clapast, 97 méga-hertzs, chaque mercredi. Il dure quatre heures de suite. Ce qui m’intéresse démarre avec le be-bop. J’ai des obsessions. J’ai acheté TOUT Charlie Parker. Quand j’avais 18 ans, j’avais acheté les premiers disques d’Omette Coleman. Tu vois ? Ça venait de sortir. Il y a deux ans, j’ai retrouvé Art Peper, alors, j’ai acheté tous les disques d’Art Peper. Avant France-Musique… J’ai tout de Téléonius Monk, de Rollins, du Art Ensemble of Chicago et Coltrane m’intéresse à nouveau.
Je vais au cinéma mais moins qu’avant quand j’y allais quatre fois par semaine. Je consomme très très peu de littérature française et beaucoup de littérature hollandaise. Je consomme aussi beaucoup de journaux de différents types. Enormément ! Toute la presse. Ça, c’est typiquement hollandais. J’avais la télé. Elle est cassée. C’est rien. Si j’avais du fric, j’achèterais un magnétoscope.
Je ne pouvais pas, à un moment donné, résoudre un certain nombre de problèmes sculpturaux, environnementaux dans les expositions alors j’ai fait de la photo et du super 8. J’ai eu d’abord une caméra super 8. Je me promenais. Je faisais des films de promenade, un tas d’images. Tout à l’extérieur. Apprendre à marcher avec la caméra. Il y avait des photos aussi, des itinéraires dans la ville. C’était une histoire complètement mentale : première rue à gauche, première rue à droite, première rue à gauche, première rue à droite, première etc. Tu photographies ça. Puis, tu le colles ensemble. Etant donné qu’on reconnaît les photos, il se passe quelque chose dans la tête. Je disais : « C’est de la sculpture. » C’était toujours préprogrammé sans aucun but. J’ai commencé par des trucs très bêtes dont : « Quelques aspects de la culture sauvage à Montpellier. » C’étaient des photos de mauvaises herbes en centre ville. Il fallait les trouver ! Marcher de 6 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir. Alors je marchais… Bon, c’était rien. Je ne l’ai jamais montré. Mais c’était un changement complet par rapport à la sculpture sur pierre que je faisais sur une sellette et tu tournes toujours autour de ce point central. La lumière est arrivée.
En super 8, j’avais un projecteur sonore mais pas au point et en plus, je n’avais pas besoin du son. C’étaient des choses qui n’avaient pas d’histoire. La caméra était là en face, il y avait des dunes ou des collines et moi je marchais, je passais de l’autre côté, je revenais, je faisais un aller-retour et je dévissais la caméra et je faisais le même aller-retour avec la caméra. Quand on voyait que je disparaissais à un certain endroit, il y avait une tension. Qu’est-ce qu’il y aura derrière ? Bon… bien sûr… Rien ! Et quand tu fais demi-tour, que lu remontes la colline, tu vois un paysage que tu n’as pas pu voir avant. C’était toujours comme ça. Un peu chiant, un peu long mais… Ça durait dix minutes. Je considérais ça comme des sculptures.
J’ai fait une série de diapositives du mot ICI sur une pancarte plantée dans tous les paysages d’Europe. ICI n’était jamais ici puisqu’il était tou¬jours là-bas. Et sur l’écran était collé le même mot ICI. Les mots ne se superposaient jamais vraiment donc il y avait deux ICI qui n’étaient jamais là. Ça passait à très grande vitesse. Les choses étaient donc ensemble et on ne pouvait jamais les voir ensemble…
En ce moment, il y a deux choses pas importantes mais marquantes. La grande vague de peinture, bad painting, trans-avant-garde, néo fauve, new wilde, figuration libre française mais moins et un net retour à la sculpture. Je le sais depuis 3-4 ans parce qu’on l’a senti venir. Les organismes officiels commencent à s’intéresser à la sculpture. Les choses vont se débloquer. Le 1 % est une chose totalement mauvaise. Ça toujours été mal fait. Quand on construit un bâtiment et qu’on met une sculpture devant, ils ont le même âge et ils vieillissent mal ensemble. C’est beaucoup mieux de violer un espace, d’y ajouter quelque chose. Sinon, ça reste une histoire d’architecte. Tout se passe par vagues dominantes. Il y a eu l’art conceptuel. C’étaient des peintres qui faisaient des sculptures et qui s’appelaient artistes.
L’agent, le capital a décidé de casquer pour la sculpture. C’est la seule possibilité… La meilleure façon d’être artiste, c’est de faire de l’aqua¬relle. Tu n’as pas besoin d’atelier. Tu fais ÇA… dehors quand il fait beau. Tu prends ton carton à dessin et tu sors… Une grande pièce de Serra demande un chantier naval. Il faut de l’argent… Et du culot…
Michel Borse à Brétigny.
A celle question sur l’espace, je dois dire que le terrain qui nous est proposé devant le centre culturel m’a surpris par rapport au film vidéo de l’année dernière. Il donnait l’impression d’être plus grand, il m’a paru coincé entre les bâtiments du centre et ceux qui sont derrière. On peut rêver sur un espace comme celui des champs labourés qui sont de l’autre côté de la route bien que sa configuration soit plane et moins intéressante à travailler. Je me suis beaucoup ballade sur le terrain. Nécessité de marcher dedans. De voir comment on circule. Comment ton projet va fonctionner. Cet espace me ques¬tionne. L’architecture qui est autour, plus loin, aussi. Une architecture dure. Une architecture minimum. L’architecture fait maintenant dans les bureaux d’études, on a complètement oublié ce qu’est un paysage, un environnement, la manière dont on doit inscrire quelque chose dans un espace, une cohabitation, une harmonie, une certaine respiration. C’est pour ça que le principe actuel du 1 % est absolument détestable. Tu devrais pouvoir travailler avec le lieu, être en adéquation avec.
Face au terrain à présent, j’aurais besoin d’avoir mes matériaux, la pelle mécanique, et travailler. D’ouvrir la tranchée, de modifier, de voir de quelle manière cela peut fonctionner. Pour moi cette exposition est avant tout une rencontre avec les autres sculpteurs. Voir de quelle manière mon travail va poser un certain type de questions.
Dans ce sens, le fait qu’il n’y ait plus d’atelier à Paris est dommage. L’espace de travail est éclaté. 11 n’y a plus de discussions, de confrontations d’idées. Moi, j’ai plutôt une certaine tendance à travailler seul, sans m’occuper de ce que font les autres. Mais paradoxalement c’est quelque chose qui me manque. Il y a une individualisation forcenée. Bon, d’accord, avec la vie qu’on a, on a besoin de se retrouver seul pour préciser les choses mais regarde Giacometti, Brancusi, tous ces mecs-là, ils avaient des ateliers proches, pouvaient se rencontrer. Il y avait des quartiers privilégiés où tu trouvais des ateliers. Maintenant tu ne trouves pratiquement pas d’ateliers ou alors ils ont été rénovés et ce sont des bourgeois qui les habitent. Moi, ce qui m’intéresse c’est la confrontation plutôt qu’articuler un propos. Tu peux toujours articuler quelque chose, seul, dans ton atelier. Ici, il va y avoir des problèmes sur le terrain, chacun va être confronté à la nature du terrain, à l’espace qui lui est donné. J’ai des dossiers pleins de notation, de projets, pratiquement je ne m’en sers jamais, je ne les regarde pas. Je suis pour le mouvement, l’action. Les projets on peut en avoir des tas, ce n’est pas mon truc. C’est agir. Mes sculptures sont toujours montées d’une manière rapide. Certaines sont montées très rapidement.
J’utilise des matériaux industriels, des structures métalliques. Matériau intéressant parce qu’il est déjà conceptualisé. Il a une détermination qui m’est imposée. Je fais cohabiter des matériaux industriels et des maté¬riaux naturels ce qui me permet de jouer sur différents tableaux. Coha-bitation et questionnement. J’utilise leurs qualités intrinsèques. Cohabita-lion et questionnement. Pour les poutrelles c’est le côté agressif, dur. Et dans la branche, c’est le côté anarchique de sa croissance qui m’intéresse, son aspect aussi. Ce ne sont pas n’importe quelles branches — la racine, par exemple, ne m’intéresse pas — elles ont une espèce de calibrage elles sont choisies. Il y a toujours cette notion de choix qui intervient. Elles viennent en contrepoint de la structure métallique.
Pendant très longtemps, il n’y avait aucune courbe dans mon travail. C’était des angles, des choses très sèches, très dépouillées, austères. Je suis venu au matériau naturel à travers le matériau métallique. Je me suis posé le problème : structure métallique = lourdeur, agressivité, géométrisme, etc.. J’ai trouvé des structures métalliques qui avaient d’autres qualités, la souplesse, la façon dont on pouvait les tordre, et là j’ai intégré les courbes. C’est avec les fers à béton que j’ai retrouvé le côté linéaire, le côté dessin, la possi¬bilité de faire jouer le vide. La poutrelle était opacité et je voulais faire jouer aussi la transparence, l’ouverture. C’est par ces courbures métalliques que je suis arrivé aux matériaux naturels : les branches, les pierres, la terre, le sable. Dans le pavé c’est la structure granitique, la pigmentation, qui m’a intéressé. C’est le côté matière à la fois brute et travaillée. Quand on regarde un pavement on a l’impression d’une forme rigoureuse, pourtant un pavé c’est relativement mal taillé.
Je me suis pas mal ballade dans les villes, j’ai fait pas mal de photos, l’urbain est important pour moi. Dans ma sculpture, il y a toujours ce principe du déplacement, quelque chose qu’on découvre, qu’on a sous les pieds. Quelque chose que — j’aimerais — que l’on voit, que l’on sente avec son corps. J’ai fait beau¬coup de photos d’affiches lacérées. Il y avait cette notion de hasard et cet éclatement de l’image et du langage. Il y a une poésie phénoménale dans les villes et les gens ne la voit pas. Il y a des connotations qui se font, il y en a, il y en a eu plein pour ma sculpture, c’est tout à fait évident. Si tu es attentif, c’est fantastique.
En sculpture, s’est tenu pour moi un discours très important, le discours minimaliste. Evidemment nous, on arrive quinze ans plus tard… Il y a une chose qu’il faut dire, il existe une tendance classique et une tendance baroque. On les retrouve partout, en littérature, en musique, en peinture, en sculpture. D’un côté un souci d’ordre, une rigueur, le linéaire, le dépouillé, l’austère, le géométrique. De l’autre, le rythme, le gestuel, l’impulsif, l’informel, le débordement. Ces langages ont été tenus à des époques données. Souvent séparés. En réaction. C’est une impasse. Je suis obligé de réfléchir à ce qui a été dit car je n’ai aucune envie de le redire. Chaque sculpture est une démonstration. Je ne veut pas me laisser enfermer dans un discours qui a déjà été tenu. Classique ? Baroque ? Je crois qu’il y a moyen d’articuler les deux.
Je suis très attaché à la notion de mouvement et à tout ce qui en découle. Déplacement, circulation, cheminement, choix, hasard, passage, abris, appui, croisement, halte, rencontre. Ma sculpture fonctionne avec ça.
Mon travail sera détruit. Ça ne me gêne pas, ça n’a aucune importance. De voir de quelle manière il va être détruit m’intéresse. Comment ses parties consécutives vont-elles se transformer pour n’être plus rien ! Quelle trace va laisser mon travail dans l’esprit des gens !
Je ne sais pas. Je suis à la fois intéressé par ce que les gens vont penser et à la fois indifférent. Je n’ai pas de problématique pédagogique. On ne m’a pas apporté les choses, je les ai découvertes tout seul. Maintenant, c’est sûr que les gens vont se demander comment ça fonctionne, qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce qu’il faut en penser, qu’est-ce que pense le sculpteur.
Là, il faudrait prendre les’ gens avec leur culture, presque séparément, et leur expliquer, par rapport à celte sculpture. Dans l’enfoui, dans leur culture, ça va laisser une trace. Une trace c’est une cicatrice. Qu’elle soit ouverte ou fermée. J’ai rédigé quelques petits textes explicatifs sur mon travail. Mais j’ai toujours pensé que c’était inutile de parler de ce que l’on fait. C’est ce que l’on fait qui est important. La manière dont on regarde. C’est l’expérience qui importe.
Pour moi, un texte sur mon travail doit être désossé, dégraissé, assez sec, assez technique. Etre une explication du fonctionnement global de la sculpture. La personne qui fait les choses est la plus à même de s’expliquer sur son travail. Elle est un phénomène culturel au sens large : milieu social, choix, intérêt, contour physique, expérience… Toi tu arrives avec une autre culture. Celui qui est à l’extérieur, qui porte un regard sur ma sculpture me semble automatiquement réducteur.
Pour moi Brancusi est incontournable. Le minimal art s’articule autour de sa sculpture. Giacometti est très important aussi. C’est peut-être le sculpteur qui a le plus travaillé l’espace. Ce sont mes sculpteurs de chevet comme on parle de livre de chevet. A un degré moindre Gonzalès. Et puis le génie de Picasso à faire de rien quelque chose de fabuleux (boîte d’allumettes, ficelle, chiffon, brique, pierre, objets récupérés…). Toute la sculpture moderne est là-dedans. A part eux, ce qui m’intéresse le plus c’est la sculpture américaine. C’est ce qui correspond le plus à mon travail, à ma sensibilité. Certaines sculptures de David Smith. Et puis tous les minimalistes, Tony Smith, Robert Morris, Cari André, Don Judd… Chez les plus jeunes, Eva Hess, Serra, Smithson, Heizer, Di Suvcro, Joseph Beuys et Mario Merz en Europe. Ulrich Ruckriem qui expose actuellement à Beaubourg développe un travail très important.
Je vais systématiquement dans les galeries et les musées. Je n’ai pas de formation Beaux-Arts, la sculpture je l’ai apprise seul en regardant de quelle manière ça fonctionnait chez les autres. Je trouve qu’à Paris on ne voit pas assez de choses nouvelles. On a vu très peu de sculpteurs américains depuis dix ans, et c’est eux malgré tout qui ont élargi le débat, qui ont eu de l’audace, qui ont pris des risques. Il y a une barrière commerciale d’intérêt économique, d’école, de pouvoirs. Je vais beaucoup au cinéma et la musique est importante, le jazz beaucoup. Je lis moins actuellement, moins de livres, beaucoup de journaux. On manque de temps mais la poésie est absolument nécessaire.
Francis Limérat et la conquête de l’épaisseur.
Mon travail fonctionne toujours avec le mur. Une remarque que l’on me fait souvent : « Quand passes-tu en trois dimensions ? » Y-a-t-il une potentialité troisième dimension dans mes travaux ? Pour moi, cette potentialité doit rester collée au mur. Mon boulot, indépendamment de son caractère périssable, ne peut être dehors. J’ai rencontré un architecte qui me propose de travailler dehors ou à l’intérieur sur un grand espace monumental et j’ai des difficultés énormes à conceptualiser cela. A partir des plans que j’ai, je cherche absolument des murs où m’accrocher.
Mon travail est une très lente conquête de l’épaisseur. C’est un système additif qui part toujours du plat. Ce n’est jamais comme un sculpteur, dans l’image la plus conventionnelle, qui tourne autour d’un bloc, qui va l’entamer, qui cherche des angles de tir visuel. Moi, j’ai besoin d’une surface et que l’épaisseur, que l’espace, aussi bien dans la verticale, dans l’horizontale que dans la profondeur, soit plus mental que réel. Le jeu des ombres est important. C’est le rappel. Plus la baguette, la ligne s’éloigne du mur, plus l’ombre s’atténue. Les lignes d’ombre viennent cribler. La troi¬sième dimension est une énergie potentielle au repos. Le blanc, par exemple, sur une baguette, introduit une fracture, une rupture car la ligne d’ombre derrière, elle, est continue.
Exposer, dirai-je d’une manière très humble, est une façon de me rassurer. Je n’arrive pratiquement jamais à percevoir la réalité de mon travail. Il y a eu deux temps. Une longue période pendant laquelle les choses se sont accumulées dans l’atelier. Posées les unes sur les autres, elles s’annulaient. Et un deuxième temps où ça a commencé à marcher et où les choses disparaissaient à droite et à gauche. J’ai toujours eu l’impression de ne pas savoir vraiment où j’en étais comme si j’étais passé du trop-plein à l’hémorragie. Une exposition, c’est une manière de me dire que j’existe.
J’utilise essentiellement du bois, des baguettes, de la ficelle, de la colle, n’importe quelle peinture, du brou de noix. Souvent des matériaux très archaïques. Des matières naturelles. La ficelle prend de plus en plus d’importance. Elle pendouille de plus en plus. Elle devient ligne. Au début, ce n’était pas une ligne. C’était une ligature, un nœud. D’abord, il n’y en avait pas. Il y avait de la colle et des clous. Une pince à linge pour tenir le tout, comme serre-joint, et toc, ça tenait. Au bout d’un moment, j’ai commencé à introduire des lignes de tension. Il fallait que j’ai des points de fixation plus résistants, alors j’ai utilisé la ficelle. Ça permet la ligne ronde sur une ligne triangulaire par exemple. Alors, je me suis demandé : « Quel est le plaisir esthétique que je peux trouver là-dedans ? » Ensuite, je me suis rendu compte d’une chose : la ficelle a comme destinée de tomber. La baguette en bois, je peux la dresser, la casser, la tordre, la briser, la foutre en l’air, tandis que la ficelle, c’est une ligne qui m’échappe. Une analogie m’a semblé intéressante. Je viens de la peinture et je pense que finalement je peins toujours. Dans la peinture abstraite, j’ai été séduit, à un certain moment, par la coulure. J’en suis, à peu près, convaincu : ma ficelle est l’équivalent de la coulure. A partir du moment où tu traces un grand geste, la couleur est là. Après, tu couvres ou tu laisses. Ma ficelle, c’est la même jubilation que la coulure en peinture.
La fonction du nœud dans un premier temps était technologie de pacotille. Si je veux courber absolument une baguette, il faut que je la noue. Le nceud, la ligature sont aussi une manière d’affirmer le caractère très gestuel de l’affaire. Je fais un travail en bois et un travail graphique. Ce qui est intéressant, c’est le jeu des équivalences graphiques et des énergies. C’est souvent de l’ordre de l’arbre et de la construction que l’on fout dans l’arbre. Ta palombière, si tu la construis sur un arbre en pleine croissance, au bout d’un moment, elle va prendre un sacré coup. Il m’est arrivé d’utiliser du métal, un ressort de matelas ou un cercle mais complètement stabilisés dans leur énergie. Je m’en sers comme ligne. Je les couvre avec un brou de noix et une colle. J’annule leur essence.
Un texte qui serait à écrire ou qui a déjà été écrit deux, trois fois sur moi, c’est un texte qui tout d’un coup, dans un moment de blocage total, je vais lire, relire et qui va me redonner le sens de ce que je fais. Ce n’est pas obligatoirement un texte pédagogique ou didactique mais bien un texte qui va me rappeler ce que je fais en réalité. Je parle de son objectif, pas de sa forme. Ce peut être un texte narratif ou poétique. Le rôle du texte, c’est d’être une note de rappel. A tel moment ça été ça, à tel autre moment, ça a été ça. Il doit permettre de se ressourcer. Je relis certains textes dans des moments de détresse. Un texte est pour moi un retour comme la mémoire ou la photographie pour des expositions passées. C’est la position du travail à un moment donné.
Je fonctionne par découvertes, par emballements. Par moments, j’ai un rapport privilégié à la musique. J’écoute du jazz parce que ça me semble être quelque chose de très très proche de mon travail. J’adore Mingus, Coltrane… Je les ressens très en écho. J’écoute du blues mais aussi du flamenco, de la musique andalouse. J’écoute en général de la musique assez brute, assez primitive. Cela dit, ce que j’aime dans le jazz, c’est que c’est un primitivisme assez sophistiqué. Je ne consomme pas beaucoup d’art plastique et paradoxalement très peu d’histoire de l’art, d’art de l’histoire. Je questionne toujours la modernité. J’ai besoin de cadrer, de savoir dans quel moment artistique, je vis. Je ne porte pas plus un jugement négatif que positif. Cela vient sans doute d’une maturité que j’ai pu acquérir par rapport à mon travail. Je veux savoir. C’est tout. Par contre, je vais volontiers à telle exposition de Bertholin ou de tel Américain exceptionnellement à Paris. Malheureusement, je ne vais pas au cinéma, pour des raisons de temps, aussi souvent que je voudrais. Jamais de ballet. Théâtre très rarement. Je consomme de la radio. Parfois, je l’écoute, parfois, c’est un fond sonore. Je consomme du bruit. J’aime bien consommer le bruit de la rue. Pour moi, c’est une musique. Je me fais chier à aller écouter un concert de Cage parce que le cadre culturel m’emmerde mais par contre, j’ai tout compris et donc ça me suffit d’entendre la mobylette qui passe.
Je vais fréquemment au Musée de la Porte Dorée. Les peintures sur écorces des aborigènes d’Australie, j’adore. Là, je me ressource beaucoup. Il y a très peu d’artistes contemporains qui me font le même effet. Il y en a. Par exemple, Tapies, c’est starter pour moi ! Il y a dans la peinture espagnole notamment une identité, une espèce de dynamisme très blanc/noir que je ressens très fortement.
Le travail de Tony Grand me paraît très important. Aussi celui d’un Californien totalement inconnu en France, que j’avais découvert il y a quatre-cinq ans, Charles Arnoldi. II fait des choses très très proches des miennes mais pas porteuses comme les miennes de toute une histoire de l’art occidental. Il y a plus de branches. C’est plus écolo entre guillemets. Ce que je fais est beaucoup plus redevable du constructivisme. J’aimerais faire la jonction entre le travail complètement pulsionnel d’un Bram van Velde et la rigueur de Tatline. C’est aberrant. Ils sont deux chocs. Mais je crois que dans mon travail, il y a un peu cela, ce désir de conjuguer ces deux oppositions. Ce qui serait Bram van Velde serait le geste, ce que l’on met, que l’on arrache, que l’on redécoupe, etc., etc., mais qui ne peut fonctionner que sur un cadre. Mon but est de pervertir, jusqu’à disparition, un cadre.
Lac — Chapelle — Avion : Jean-Loup Ricur.
La première fois que j’ai vu le terrain devant le Centre Gérard-Philipe, je l’ai trouve grand. Ça manquait d’arbres. Ce n’est pas tellement le terrain qui m’a fait le plus d’effet mais le parcours que j’ai fait en auto pour y arriver. J’ai pris pour y aller cette nouvelle voie rapide. On ne passe plus à travers les villages et à Brétigny, c’est pareil. C’est un pays bizarre. Il y a pratiquement autant de champs au milieu des maisons que de maisons au milieu des champs. On est dans les champs, partout. Le Centre culturel est une maison de la culture pratiquement au milieu des champs. C’est drôle. Le grand terrain sous le château d’eau est extraordinaire. Il y a un super Prix-Unie et à côté un champ…
Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la nature de la terre, la nature du terrain par lui-même. Une fois qu’on arrive et qu’on a les pieds dedans, c’est le cas de le dire, la chose la plus intéressante, c’est d’être rivé comme ça dans cette terre qui est lourde, qui est d’une densité fantastique. C’est vraiment de la terre pour construire. Il y a assez de cailloux pour qu’il n’y ait pas trop de retraits. Ça fait une masse compacte, très plastique.
Exposer, pour moi, c’est important. Ça me fait sortir de mon jardin pour être confronté à un jardin un peu plus grand avec des problèmes un peu différents de ceux que je me crée à l’intérieur de mon univers. J’ai beaucoup bossé parce que ça a soulevé toutes sortes de problèmes au point de vue réalisation. Ça a mis l’accent sur le fait qu’un travail fait à une certaine dimension dans mon jardin avec des matériaux bien précis, des ardoises, ou peu de pierres sont mises en œuvres, ne peut pas s’extrapoler comme ça. Il ne donnerait pas à une autre échelle automatiquement une œuvre intéressante. C’est complique. On ne peut pas simplement déplacer. Ce serait exotique dans le terrain, complètement étranger. Ça amènerait peut-être un sentiment de curiosité. Brétigny n’est pas saturé d’ardoises mais mon travail, c’est quelque chose de dit avec l’ardoise. Ce n’est pas spécifiquement l’ardoise qui est présentée.
C’est toujours la réalisation de l’œuvre en situation qui m’intéresse. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été une confrontation dans un lieu, dans une architecture. Des réalisations extrêmement classiques. II y a une trentaine d’années, ce n’était pas du tout du land art. La mosaïque murale est une occupation plus classique que mes travaux actuels mais en fait, ça a toujours été cette démarche. Ça tient compte des espaces, de l’air autour, de la lumière, du lieu, de la proximité des choses dans le lieu.
J’utilise depuis des années le ciment, l’ardoise, la pierre. Des matériaux avec lesquels on construit. Ce sont toujours des murs. C’est rarement dans la nature, dans l’espace comme ça en soi. Ça a toujours été pensé pratiquement en tant que chose liée à l’espace construit. C’est obligatoirement une sorte de peau. Ça s’applique sur le mur. Mes premières réflexions pour Brétigny ont été : « Comment stabiliser le terrain pour que cela ait un devenir construit ? » Dans le genre, l’expérience la plus drôle a été de faire des billes de terre roulées dans le ciment pour arriver à de petites billes dures et de couleurs, pour ensuite les entasser en pyramide. Avoir une action avec le terrain, s’en servir pour le terrain ! Tout cela étant lié à l’ardoise. Seule, elle ne pouvait pas tenir. Il fallait l’appuyer, la lier à quelque chose pour que ça ne flotte pas, que ça ait la densité que ça a dans les petites constructions. Je voulais cerner les ardoises avec ce ciment teint, granulé et en même temps les lier à la terre. Après, il y a eu l’arrivée des branches. Pratiquement, je voulais recréer le jardin. J’avais besoin d’arbres dans ce terrain pour interrompre l’espace, qu’il se passe quelque chose, qu’il y ait une trame comme dans le jardin où je vis pour que le regard puisse s’arrêter, qu’il y ait un volume d’air autour des ardoises, un espace dans l’espace.
On ne devrait pas parler du ciment mais des mortiers. Ce serait plus juste. Je dis facilement ciment parce que c’est l’élément qui lie les choses, qui essaie de les réunir mais en fait ce qu’on voit ce sont des mortiers. Selon les agrégats que vous mettez à l’intérieur, ça prend des teintes différentes.
La fresque m’a extrêmement passionné. La couleur intégrée au support. Une chimie avec le mur fixe la couleur. La fresque véritable, c’est la couleur passée sur un fond de chaux qui est projeté sur le mur et c’est le carbonate de chaux qui fixe. C’est un mécanisme extraordinaire. Et en plus, bien souvent, les fresques étaient reglacées, intégrées et même avec des effets de relief. Légers évidemment… Spatules à l’intérieur du mortier ! C’est un domaine dans lequel je travaille un peu. Maintenant, on fait des mortiers qui n’ont plus besoin d’avoir le carbonate de chaux pour protéger la couleur. Ce sont des résines spéciales qui font qu’il y a d’autres chimies.
Tout ça, c’est une vieille histoire, mon vécu, qui fait que mon truc c’est pas le dessin, sauf des croquis par nécessité, c’est penser, résoudre à travers le mortier. Je suis même coincé par des histoires comme ça. Tout dans le support. Avec même des fois des rejets violents puisque le plus gros rejet que je puisse avoir, c’est d’avoir fait pendant de nombreuses années de la mosaïque et de ne plus pouvoir y toucher. J’arrive juste encore à poser comme ça les pâtes de verre sans liant. Ça ne peut passer qu’à travers des techniques que j’ai employées pendant vingt-cinq ans. C’est fou, non ?
L’ardoise est une pierre qui a cette qualité extraordinaire de pouvoir se déliter et se transformer en feuilles très très minces. Il y a quelques autres matériaux qui ont cette propriété, des laves, des phonolites. L’ardoise a la même composition que l’argile au point de vue physique mais elle a subi des transformations et des pressions. Comme pierre, c’est en même temps très dur et très fragile. Très, très sensible. Ça m’a beaucoup frappé. Géologiquement, ça a subi des pressions fantastiques. Des failles de cristallisation, des ruptures se provoquent à l’intérieur des bancs d’ardoise. Ça donne des pierres au découpage très très géométrique. De façon naturelle, on trouve à l’intérieur, des fois, des parallélépipèdes parfaitement rectangles ou des triangles très très bien dessinés. Ce n’est pas courant-courant mais ça existe. C’est quelque chose de très plan. Et ça se refend très bien. C’est ce qui permet d’avoir des ardoises de toiture. On les prend à la sortie de la mine avec leur eau de carrière, quand elles sont encore saturées d’eau et là, on peut refendre jusqu’à trois millimètres d’épaisseur. Il y a des ardoises de toiture qui ne font pas plus de trois millimètres d’épaisseur. Donc ça fait des bancs qui sortent, qui ont deux champs de chaque côté, très plats, très plans et qu’on réduit au fur et à mesure, qu’on replant si bien qu’on arrive à avoir des feuilles, des plaques. C’est le livre. J’appa¬reille chez moi des pierres à livre ouvert c’est-à-dire deux pierres qui ont le même profil, le même dessin. On peut comme ça travailler avec des pierres identiques, des pierres jumel¬les ou répétitives. Pour le marbre, il faut la machine. Là, sans, on obtient des choses très fines, très découpées. C’est d’ailleurs un matériau très répandu dans le monde. Il y en a un peu partout. De couleurs différentes. Ce n’est pas forcément gris ou noir. Ça peut être brun ou vert. Il faudrait parler plutôt de schiste que d’ardoise. Enfin, c’est cette rigueur, ce côté déjà réalisé dans le matériau… Il n’y a plus qu’à mettre en valeur, à situer dans l’espace. C’est ça, c’est une question de situation.
Les matériaux pour « l’avion » ou « le chapeau », selon ce que nous choisirons, seront tout à fait différents. C’est une sorte de soulagement de pouvoir travailler sans les ardoises. Il y aura du mortier et des branches. Le mortier, plastiquement, va suivre le terrain. Il n’y aura pas un traitement particulier du terrain pour dessiner l’avion. Il va suivre le terrain comme une ombre projetée, à terre. Ce mortier, on va le poser au minimum. Bien sûr, s’il y a une motte qui dépasse, on va pas s’amuser autour de la motte, on va la tasser mais on ne va pas provoquer un travail de tassement préliminaire pour dessiner cet avion. Il faut qu’il coule comme une ombre. Les branches vont être plus plantées par rapport à l’allée qui va traverser l’avion que par rapport à l’avion lui-même. Ce sera pour créer un espace vertical au-dessus du terrain, pour que ce soit intégré. Les branches, c’est l’espace construit. C’est cette obligation de l’espace construit. Et si la végétation veut pousser dessus, ce sera formidable. Pour que… les gens puissent participer… que ça devienne marrant… que ça n’ennuie personne… que ça soit une promenade… tout simplement..
L’intérêt, c’est de fabriquer les choses, le vécu. Ce n’est pas qu’on fasse les choses sans penser aux gens, non… Mais que ça ne reste pas dans l’espace-temps, ce n’est pas très important.
Un texte doit être le véhicule qui fasse que les gens aient envie d’aller voir ce qui se passe. Ou, au contraire, qu’il dise aux gens : « N’allez pas là- bas. C’est tellement ringard. Surtout n’y allez pas. » Il faut être critique et informatif. Essayer d’être au plus près de la question.
Il faudra aller voir Damian et Reynauld au Grand Palais. Puis, j’aime beaucoup Monsieur Pages. La dernière exposition très marquante a été pour moi « Atelier 81-82 », Je vais rarement au concert ou au cinéma. Je vais souvent voir des expositions, toutes les manifestations qu’il m’est possible de voir. En fait, assez casa¬nier et très très dans les problèmes particuliers de la peinture et de la sculpture. Peut-être trop d’ailleurs. Je lis des romans, des essais, certains Pivot quand ils sortent. Avec la télévision, j’ai une habitude qui énerve mes femmes (Suzanne, mon épouse et Françoise, ma fille). Je suis les trois chaînes en même temps. C’est possible. Quatre, je ne sais pas. Trois, c’est possible.
Emmanuel Saulnier : Joindre le geste à la parole…
La première fois que j’ai été à Brétigny, je me suis vraiment interrogé. La formule de l’exposition, la formulation des organisateurs m’intéressait mais l’espace avait un handicap énorme à sa vue première. Il m’était apparu à la fois petit et grand, motivé et immotivé. Ce champ de terre et sa dimension étaient motivés. Son alentour le condamnait à être un périmètre enfermé entre des bâtiments et ne motivait plus ses dimensions. Je me trouvais devant cette contradiction avec en plus, le bâtiment du centre culturel qui est, à mon sens, altéré pour différentes raisons, dont, entre autres, la présence d’une oeuvre permanente, très présente et qui matraque le lieu. Ensuite, je me suis aperçu que le lieu pouvait être le point de départ d’une vue et même d’une ligne d’horizon, ce qui arrive rarement dans un espace culturel. Cette ligne d’horizon présente des caractéristiques intéressantes en tant qu’espace. A savoir : la présence des arbres, la tranquillité, l’espèce d’état de nature assez sobre avec en fond arrière l’architecture d’un château d’eau, des maisons, des bâtiments. J’ai donc décidé d’utiliser l’espace donné comme départ d’un point de vue. Ça s’est formulé petit à petit. Et, ensuite, il n’y avait plus qu’un problème d’organisation à régler avec les animateurs du lieu.
Pour moi, maintenant, cette exposition est devenue très subjective. C’est la première fois que j’ai l’occasion de travailler un espace que l’on voit d’un autre espace. De fait, cela ne se concentre qu’à cela. Cela ne devrait pas mais cette donnée initiale m’en fait donner cette définition.
Pour moi, exposer, c’est chaque fois formuler le propos et chaque fois le conduire dans une hypothèque différente. Pour moi, la peinture, la sculpture, le dessin se formulent en termes de recherche et pas du tout d’objectivation. L’objectivation n’est que l’un des canaux de la recherche.
Ici, l’état et la situation des lieux sont les éléments de l’hypothèse. Éléments fondamentaux. Je me demande si c’est possible, dans un espace donné, de donner à voir un objet sans qu’il soit enfermé dans le susdit espace. C’est pour ça que la formulation « Dedans-Dehors », en l’occurrence, résonne à mes oreilles d’une façon tout à fait juste. De dedans à dehors comme cela aurait pu être de dehors à dedans. C’est évidemment l’un ou l’autre qui sont en jeu et il se trouve que dans le cadre de cette exposition, c’est vraiment ensemble que cela se formule.
Il n’y a pas de matériaux privilégiés si ce n’est, à mon sens, ceux qu’on utilise chaque jour. Ils peuvent être chaque jour différents. C’est surtout fonction du besoin, de la formulation de l’espace que l’on a.
La lumière est pour moi l’élément moteur, suggestif. C’est le plaisir et le résultat, le départ et l’arrivée. C’est l’élément conducteur de la forme. C’est celui qui est le moins objet de tous les objets et celui qui est le plus vivant de toutes les formes. Alors, de fait, je suis amené à chercher les éléments qui conduisent la lumière, qui la portent, qui l’informent, qui la reflètent, qui la donnent, qui la distribuent. La lumière peut être simplement obtenue par la définition de la forme, c’est-à-dire sa modulation, quel qu’en soit l’outil. Ça, ça me semble très important. Là, le travail de Klein m’apparaît comme extrêmement intéressant et en même temps extrêmement primaire. Finalement, il formule des hypothèses, au coup par coup, sans rester dessus. Ce qui implique une hystérie du propos. Cela conduit au drame, au risque de l’absence, même si c’est nécessaire, même si pour Klein c’étaient les conditions d’une modernité, d’une nouveauté dans l’expression que je lui reconnais tout à fait. Les éléments de progression, de connaissance du matériau, de connaissance me semblent essentiels. C’est pour cela que le terme de recherche m’apparaît comme le plus juste.
Une idée très importante est celle du corps nu de la forme. Au Japon, elle apparaît de manière permanente, de tas de façon, dans les arts martiaux et dans d’autres domaines. Finalement, il s’agit d’être les mains nues, l’esprit et le corps nus, de façon à trouver la véritable dimension de la forme. Pour moi, c’est aussi l’une des idées de la modernité. C’est très très important.
La trace, on en discute souvent. Je crois que les traces sont celles qu’elles laissent. Ce n’est pas un pléonasme que j’utilise. Ce qui est beau, c’est ce que tu fais. Finalement, les traces sont le domaine des autres. Simplement, et cela m’importe, certaines formes ne peuvent pas se séparer de leur « éphémère ». Je viens de faire un travail dans une maison abandonnée. Cela ne pouvait pas être ailleurs. J’estime que c’est une constante de l’art mais c’est une constante pour tous. C’est vrai pour les Cadavres exquis mais aussi pour Léonard qui disait : « Apprenez à dessiner en regardant un mur ». Ce n’est vraiment pas le problème. Le problème, c’est la détention des signes et la volonté de les séparer d’une lecture générale.
A chaque fois qu’il y a un texte sur mon travail, je m’interroge. Il me semble que la chose essentielle soit que le texte m’informe. Un texte peut être redondance pauvre mais s’il donne une avancée dans l’imaginaire, c’est qu’il s’est lui-même apparenté au corps de la sculpture. C’est la naissance, en spirale, d’une autre sculpture à venir. Et cela me semble tout à fait légitime que ce soit d’ordre scientifique ou narratif, que ce soit romance ou rigueur. Si ce n’est pas une œuvre en soi, c’est sans corps. Les textes de type complaisant passent dans le domaine de l’anodin. Pour moi, il y a une chose importante dans le travail, c’est de joindre le geste à la parole. Cette formule implique que le texte soit lui-même un geste et que la parole ait une forme. Tout comme le geste est une parole. L’écrivain doit se mettre en danger tout comme je suis en danger.
Calder m’importe. Celui de toute la mobilité. Pas celui des dessins ou des stabiles. C’est le seul qui soit éolien. On n’a pas assez parlé du jeu chez lui, de son humour. Ça passe aussi par Giacometti, très fort. Evidemment pas le Giacometti des peintures mais le Giacometti des dernières sculptures et de tous les filiformes comme concentration et éléments simples. Ça passe par Arp, les papiers déchirés, les découpes. Et ça passe profondément par Léonard qui est le premier à dire : « On n’est pas obligé de se salir les mains. » C’est amusant : Calder est du bout des doigts, Giacometti aussi et Léonard, du bout de la tête. C’est le premier qui a la conscience universelle de la sculpture.
Evidemment, je me sens des parentés avec la grande veine des minimalistes. Mais… je trouve que Kelly, à la limite, est une brute. C’est de cet ordre-là. Très peu de plaisir. Fondamental, mais les Américains m’ennuient profondément. Cela devient invisible même quand la rigueur, des éléments de pureté sont très présents. Ils ne m’apportent pas tellement d’inspiration. Les éléments qui m’informent sont autant de l’histoire de l’art que du quotidien. Quand je dis « quotidien », cela ne veut pas dire l’information quotidienne de la société, mais mon regard dans le quotidien. En ce sens, je me sens très peu peintre ou sculpteur. Je me sens chercheur de formes. Je me sens « promeneur solitaire ». Le geste et la parole me semblent liés à la chose. Entre toi, Yves Tenret, et moi, je vois très peu de différences.
Je me promène beaucoup. J’aime voyager. C’est ma priorité. Je désire aller en Egypte pour travailler. Ma question est : « Comment chacun de nous peut-il être vivant dans les ruines d’une situation formelle encore présente et extrêmement riche ? » Tu vois ? C’est lié à la lumière présente et à la lumière acquise. Mon but, c’est d’avoir conscience de ma propre lumière jusqu’à la possibilité de l’envol vers cette lumière. Quand je l’aurais, je ne produirais plus.
Propos recueillis par Yves Tenret.










