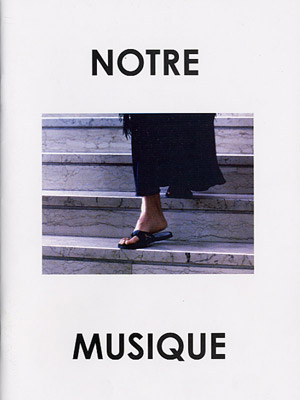L. d. S
Heureusement, par ailleurs d’autres choses se passent. Tu rappelles les bons mots de Godard, il faut aussi voir son film, cette « musique » qui est la « nôtre », « Notre musique », c’est-à-dire nos images et nous. Jamais dans le cinéma récent n’a-t-on aussi clairement, aussi limpidement parlé de nous, de là où nous en sommes, de là où nous sommes enfermés, que dans ce film – ce film qui devrait être la cause d’un miracle s’il y avait un Dieu : ce film qui devrait nous ouvrir les yeux si nos yeux nous servaient encore à regarder, et pas juste à voir. Il ne faut donc pas s’y tromper : « Notre musique » est un film excellent, parce que l’excellence n’y est pas une question de jugement mais une question d’action. Il ne s’agit pas de savoir si Godard film « bien », s’il filme des « belles » images ou des images « justes », non – ce qui compte, c’est encore et toujours ce « juste une image » prophétisé par JLG il y a plus de quarante ans, ce « juste une image » que nous continuons à chercher, qu’il continue à chercher avec une inlassable pugnacité. Godard fait du cinéma, il ne filme pas. C’est toute la différence, toute l’excellence, et tout ce qui doit nous faire penser – comme tu le sais très bien – qu’il est aussi stupide de juger une image que de croire qu’elles seraient capables de changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Là où il y a de la différence, c’est entre les images. Godard dit « champ, contre-champ », soit. Avec Deleuze, on pourrait plutôt dire « une image et une image et une image, etc. » Construire la série hétérogène des images où construire aussi notre regard, voilà ce qu’est, comme chaque film de Godard, « Notre musique ». C’est peu dire que c’est magnifique.

J . D.
Le Godard, que j’ai revu aujourd’hui. Revu parce que mal vu, parce que fatigué la première fois, donc pas suffisamment attentif à mon sens. Tu parles beaucoup mieux que moi de ce film. Tu en parles peut-être parce que tu sais quoi en dire, tu sais mieux le voir et le comprendre que je ne saurais le faire. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela. Le rapport aux images bien sûr, et puis la culture évidemment. Mais pas seulement. Peut-être aussi une question de distance aux images, une question de rapport. Pour moi les images ce n’a jamais été celle de Godard. Je n’ai jamais eu de rapport équivalent. Parce que question d’époque, question de génération, question de processus. Les images pour moi elles ont été partout, tout de suite, là, avec la télévision. Les images, et puis enfin le cinéma, c’est mon territoire, ma terre sainte, c’est chez moi. C’est la sécurité, le monde est plus vraiment faux et réel derrière les écrans. Les histoires sont sur l’écran, dans les images, et parfois entre. L’image, oui, c’est mon salut. Toutes les images. Alors, lorsqu’on est de toutes les images, où est le monde. Où est le contre champ ? Reste-t-il du monde comme chez Godard ? Il y a-t-il du nous ? Oui, il en reste, pas partout bien sûr, plus particulièrement chez Godard, mais ailleurs aussi. Ailleurs où ? Je crois que les mécanismes de production du capitalisme on crée des nécessités de fiction. Toujours plus de fiction. De la fiction partout, pour tous, sur tout et rien du tout. On se raconte tous et tout le temps des histoires, c’est une banalité, sauf que désormais, elles ne sont plus tellement dites, la parole s’éteint au profit des images. Et nos histoires sont devenues des moteurs de réalités. Elles ont contaminés le réel. Il n’y a plus de réel sans histoires, sans fictions, banales ou extraordinaires. Donc le monde est partout, dans toutes les histoires, dans toutes les fictions, dans toutes les esthétiques. Il y a bien un réel, mais il est ce qui veille, par accident, par évènement. Loin toujours, car comme le dit très bien JLG, les plus humains sont ceux qui font des cimetières ou construisent des bibliothèques. Ceci dit pour un tout petit peu situer mon rapport aux images (très mal, il faudrait que j’y revienne sérieusement).
Que faire donc d’un monde qui passe peu à peu au travers de ses images ? Ce monde est-il meilleur ? Les images nous ont-elles aidés un peu, à nous rendre meilleur, plus grand, plus beau, plus fort, et plus humain (pour ceux qui croient en lui) ? C’est peut-être la question de Godard. Peut-on dire que les images, le cinéma, moderne, post moderne, contemporain, que la télévision, l’Internet, les jeux vidéo, nous aide ? A autre chose que participer à la déréalisation, à l’effacement, au tout va bien, à nous faire moins voir le monde pour mieux le faire accepter ? Peut-on dire que les images du cinéma maintenant servent-elles à autre chose qu’à distraire, qu’à susciter le pathos ou qu’à tomber dans le didactisme à grand coup de procédé discursif sur le monde et les images ? Où se situer, comment vivre honnêtement, comment prendre position sincèrement, comment vivre simplement le cinéma maintenant ? Comment parler, juger Godard sans tomber dans telle critique, tel courant, sans s’enfermer ? Comment échapper à tout ça ? Voir seulement les images de Godard en oubliant le dispositif, la filmographie, ce que l’on en a fait. Comment fait-on pour voir des images maintenant ? Comment fait-on pour vivre seul avec les images ? Seul ce n’est pas hors du monde, c’est seulement sans l’influence néfaste des journalistes, des universitaires, troubadours de la pensée
en kit. Comment être avec l’autre sans arnaque ? Je n’ai pas la réponse. Le seul embryon, pour moi, c’est de plonger dans les images, le cinéma, et de l’aimer parfois pour ce qu’il n’est pas, pour ce que le film montre par hasard, pas pour ce qu’il dit, ce qu’il est ou voudrait être, mais pour ce qu’il a : un cadre, un plan, une lumière, un espace, une matière, une ombre, un visage, un mouvement, un raccord, pour ce que j’y vois et ce que j’ai envie d’y voir. Peut-être que pour se sauver un peu c’est tout ce qu’il nous reste, construire notre propre rapport aux images. Mais peut-être que je dis n’importe quoi.
LA différence c’est entre les images. Oui, c’est dans le raccord. C’est là que l’intime ce loge, là qu’on tombe amoureux en même temps que Cary Grant dans An affair to remember. C’est là qu’on partage, qu’on est tous ensemble. C’est là la communion.
Nos images donc, dans un monde saturé d’images, qui les construit pour les sédimenter et faire en sorte que chacun, comme avec son caddie, choisisse celle que bon lui semble. Là Godard, ici la télé réalité, c’est le monde que l’on a crée. Chacun son truc, lui le cinéma gore, l’autre les films de kung fu. La différence des images comme mode d’élection, comme construction identitaire. Et c’est pour cela, que malgré ce que j’ai écris plus haut, je ne choisirais jamais. C’est pour cela que je resterais curieux de toutes les images, de tous les cinémas, que dans la même journée je verrais un film de Fulci et un Godard. Parce qu’il faut que rien ne soit saisissable, il faut que jamais rien ne m’enferme, il faut que je sois toujours au bord, toujours à la marge pour mieux voir ce qui nous concerne.
Ce film qui comme tu le dis devrait nous ouvrir les yeux, mais malheureusement il tombera comme le reste dans les limbes de l’objet estampillé trop vite. Notre musique souffre d’un mal qu’il n’a pas voulu, qu’il n’a pas commis. Il souffre de l’élection de la pensée trop recherchée. Trop pensée justement, dans un dispositif où le spectateur crois souvent ne pas être à sa place. Godard, depuis 15 ans, fait des films que la plupart imaginent inaccessible. Un peu comme les Straub. Il fait des films qui inversement satisfont ceux qui croient qu’ils pensent. Une certaine critique, un certain public, quelques universitaires. Un autre cercle répond à l’autre. Et malheureusement, ceux qui sont les plus concernés, ne voit pas ses films, où ils ne les comprennent pas. Pour qui donc alors Godard, les Straub, font encore du cinéma ?
Malheureusement, le cinéma de JLG répond chez certain de la même manière que chez celui qui aime tant les série Z. Il n’y a pas de devenir possible. Il n’y en a plus. Les films les plus responsables, comme ce dernier documentaire foudroyant de Rithy Panh, S 21, sont à peine vu, ou bien ils sont vu mais rangés. Et quand bien même certains voudraient leur rendre la place qu’ils pourraient avoir, voilà que l’on tombe à nouveau ailleurs, dans les garants de l’exception culturel, dans les festivals engagés, dans la gauche triomphante. Non, le film ne peut plus exister détaché des limites qu’on lui a imposé. Même le cinéma de Godard, malgré lui, devient de la publicité. Ne parlons pas de celui des Straub. Au fond, qu’il y est Kill Bill ou Notre Musique, cela ne fait plus la différence.
Sans doute que Notre Musique pose la question de ce que peut être un film. Mais alors, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que Notre musique expose ? Pour cela je t’écoute, j’écoute ta musique. Je n’ai pas la réponse, le film me laisse sans voie réelle. Je suis face à lui un peu désemparé, quelque peu perdu dans toutes ses associations, ses ramifications savantes, peut-être à l’image de ce beau personnage, qui se prend le monde de plein fouet, et qui décide d’en finir. Je m’égare un peu dans ce poème, cette prose d’images et de sons toujours aussi étincelante. Je suis sûr que tu sauras me guider.

L. d. S
Godard. « Notre musique ». Mon hypothèse : que Godard annule toute question sur le cinéma. Il filme, et c’est tout. Il se contente de cet acte. Il se contente du fait qu’il y a des images, juste des images, et que ces images sont filmées. Est-ce du cinéma ? N’en est-ce pas ? Je crois que la question ne l’intéresse plus, si elle l’a jamais vraiment intéressée. Je vais plus loin. Dans ce désintéressement vis-à-vis du « cinéma », il y a un intéressement de plus en plus profond – et, me semble-t-il, de plus en plus tragique – vis-à-vis de la restriction qu’il y a à toute image (« juste » une image, c’est-à-dire rien de plus que ce « juste »). Et cette restriction, c’est nous. Nous, comme restriction des images, comme manière de les cadrer, d’afficher un interdit de montage et un interdit de regard, de montrer ou de refuser de montrer, etc. Tous les actes techniques du « cinéma », ceux qui donnent les images, et « juste » elles, sont des actes qui restreignent. Le cinéma est « la » restriction. « Notre » restriction parce qu’elle vient toujours de nous. La question, alors, philosophique, esthétique, politique, éthique, etc., est la suivante : qui est ce « nous » ? Que dire de ce « nous » ? Qu’est-ce que « nous » ? Comment filmer le « nous » ? Et la réponse de Godard, comme toujours, est limpide : on ne filme pas le « nous », comme on ne filme pas le cinéma, comme on ne filme pas du cinéma. Le « nous », c’est l’inmontrable, c’est l’indéfinissable, l’incommunicable. Godard connaît ses philosophes. Il sait ce que Bataille, Blanchot, puis Derrida, Nancy, ont dit sur le « nous » qui se trouve au fondement de toute communauté. Dire « nous », c’est un acte de force qui ignore que dire « nous » est d’abord l’échec à déployer la réalité ou la vérité d’un « nous » concret. Il n’y a pas de « nous », il n’y a que sa nostalgie (fascisme) ou sa dépression (gauchisme utopique). Comme il n’y a pas de cinéma. Il n’y a que des traces, des phantasmes, des restes, des ruines. Film-fragment qui se donne comme voix de ces ruines, « Notre musique » signe le deuil métaphysique de toutes les totalités. Il proclame l’impossible clôture du « nous », du « cinéma », de tout. Il est l’incomplet.