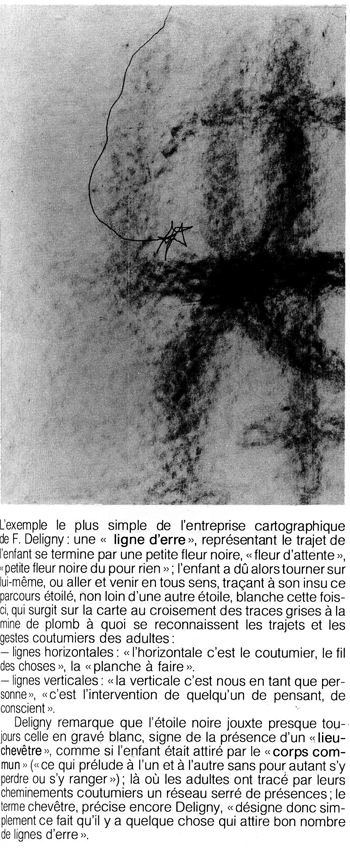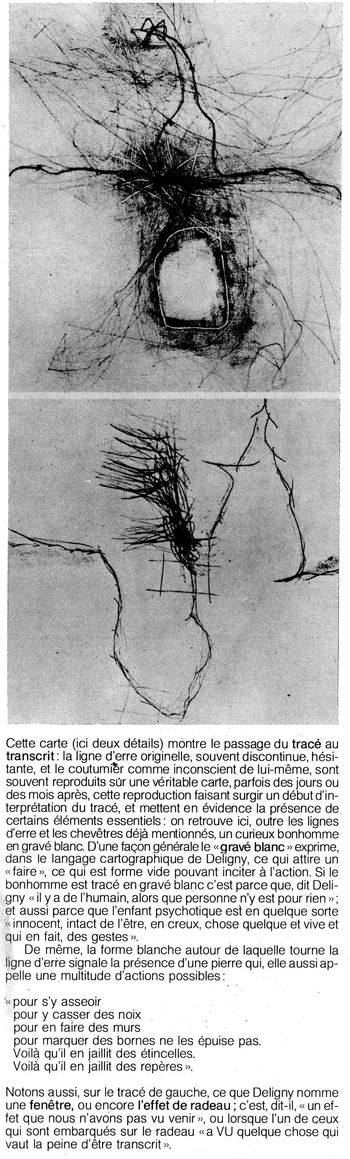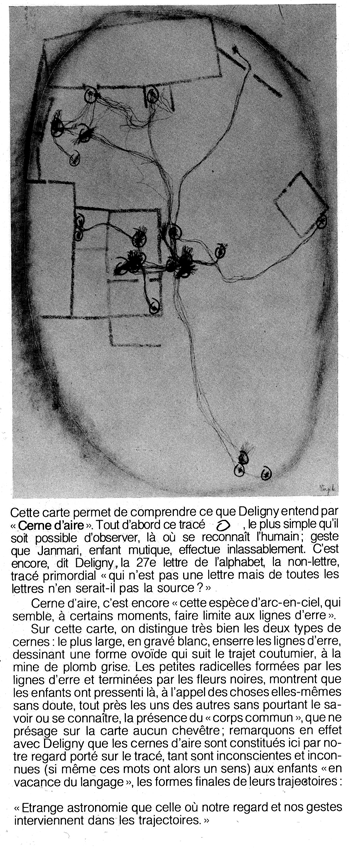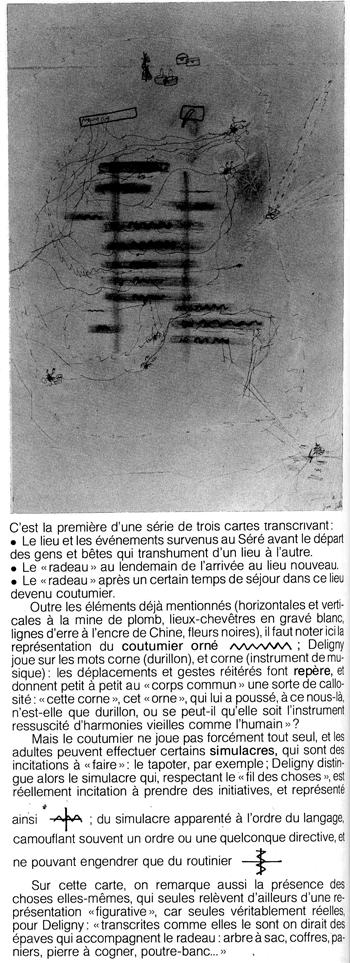Texte de Françoise Bonardel, 1980
Initialement paru dans le livre, Cartes et figures de la Terre, catalogue de l’exposition organisée par le Centre de Création Industrielle au Centre Georges Pompidou en 1980.
« Dans les vagues,
Dans les monts érodés
de la chaîne
hercynienne
Quelques radeaux
d’après le désastre » …*
Sur ces radeaux, quelques jeunes hommes et femmes, guidés par l’impulsion et l’intuition initiales de F. Deligny, vivent aux côtés d’enfants psychotiques jugés incurables, dans « la vacance du langage »*. S’ils ont, en quelque sorte, « pris le maquis » et sont, comme les enfants qu’on leur a confiés, de singuliers partisans, c’est qu’ils ont entrepris, hors de toute institution, une aventure qui fait peut-être d’eux les contemporains de nos ancêtres primitifs, de « l’homme naturel » de Rousseau, ou encore de ce Victor, enfant-sauvage de l’Aveyron… Au jour le jour, par leurs faits et gestes coutumiers : conduire le troupeau, couper du bois, faire cuire le repas…, ils marquent de leur présence cette terre austère et immuable des Cévennes, transcrivant ensuite ces trajets et multiples « faire » quotidiens en d’innombrables cartes qui « donnent à voir » ce qu’eux-mêmes ignoraient souvent jusqu’alors, et sans quoi les enfants psychotiques resteraient pour eux, et réciproquement, d’irréductibles étrangers. Ce que les cartes révèlent, à travers les nombreux tracés et le transcrit qui en est fait, là où l’enchevêtrement des « lignes d’erre » et des trajets coutumiers constitue un « lieu-chevêtre », c’est l’existence d’un « corps commun » , d’un « Nous primordial », qui ne saurait être ramené à un noeud de désirs inconscients comme le voudrait la psychanalyse, ni à un héritage de dispositions innées ; c’est bien plutôt « ce quelque chose en nous qui échappe au conjugable » , ainsi que tente de le définir Deligny, ou encore ce « fonds commun autiste que nous avons tous on permanence ».
Archéologie patiente et obstinée, silencieuse et coutumière, non d’un savoir mais d’un « faire » ; qui ne met pas à jour un sens par quoi se révèlerait la présence d’un ordre symbolique oublié ou caché, sans doute pour toujours étranger à ces enfants, mais le « fil des choses », grâce auquel l’enfant mutique peut entrer parfois en vibration avec le monde, saisi par certaines de ces harmonies « vieilles comme l’humain » ; en effet « le corps commun » n’est pas un cadastre, mais « un ensemble de moments où l’émoi n’est pas pour rien ».
Il ne s’agit pas ici de rééduquer (Deligny voit se profiler tous les colonialismes derrière ce seul mot), ni de soigner (certains lui reprocheront d’ailleurs d’enfermer définitivement les enfants dans leur psychose), mais d’entreprendre avec eux une dérive, qui est tout à la fois errance au gré des choses plus que des affects, et aussi « presque rien, un bout de bâton planté dans l’océan », c’est-à-dire presque tout pour ces enfants privés des repères les plus élémentaires, à commencer par celui d’un Moi structuré. En état d’apesanteur créé par l’absence de langage et donc de fin (tout à la fois but et terme d’une entreprise humaine), on vit ici comme « à perte de vue », dans la réitération quasi rituelle du quotidien. « Erre : le mot m’est venu. Il parle un peu de tout, comme tous les mots. Il y va d’une « manière d’avancer, de marcher » dit le dictionnaire, de la « vitesse acquise d’un bâtiment sur lequel n’agit plus le propulseur » et aussi des « traces d’un animal ». Mot fort riche, comme on le voit, qui parle de marche, de mer et d’animal et qui recèle bien d’autres échos : « errer : s’écarter de la vérité … aller de côté et d’autre, au hasard, à l’aventure ». J.-J Rousseau le dit : « voyager pour voyager c’est errer, être vagabond ». C’est aussi « se manifester ça et là, et fugitivement, sur divers objets, sourire aux lèvres ». » Mot-coquillage, dira encore Deligny, ramassé sur quelque plage de sa mémoire, tout rempli de sable…. En errant l’enfant réitère certains gestes qui, fondus dans le coutumier des adultes, l’ornent et tracent ainsi des repères.
Mais puisque l’enfant psychotique n’a pas de Moi constitué, n’est donc pas un Je sujet, face à d’Autres sujets, on ne saurait le faire évoluer par la seule reconnaissance de ce manque absolu. Deligny quant à lui refuse ce rôle de « nanti » (du langage, de la pensée…) face aux enfants irrémédiablement déficitaires ; il s’interroge plutôt sur ce qui peut bien leur manquer, à lui et à ses compagnons, pour être à ce point inexistants aux yeux de ces enfants-là. Et c’est là que la carte va jouer son rôle essentiel. La « personne » ne peut plus être désignée par ce qu’elle est (nom, personnalité, aptitudes intellectuelles réduits à néant par la psychose), mais par ce qui « a lieu » à travers Elle. Nous assistons alors à l’étonnante substitution d’une topographie et topologie à l’habituelle et ici inopérante psychologie. Encore faut-il préciser que ce qui intéresse Deligny n’est pas d’étudier comment l’enfant structure son espace vital, et par cela même développe son intelligence (point de vue applicable seulement à des enfants dont l’intelligence sensori-motrice prépare les opérations abstraites et logiques), mais plutôt comment ces « drôles d’animaux vagabonds », ces exilés, ces errants, définissent sans le savoir et le vouloir le territoire d’un « faire » qui, réitéré, orné, les mettra en relation avec les Autres par l’intermédiaire des choses.
D’où ces jeux de mots, fréquents chez Deligny, qui marquent ce nécessaire glissement de la psychologie à la topologie :
celui-là devient ce lui là
(la désignation d’une personne constituée est remplacée par la simple désignation d’une certaine réalité tombant sous un regard, occupant une certaine portion d’espace, effectuant certains gestes…)
De même « il arrive » ne devrait-il pas plutôt être écrit il a rive ? tandis que « il » serait transcrit île ? Et chacun n’est-il pas originairement chaque un ? et commun, comme un ?
Que sont-ils en effet ces enfants-là, sinon les lignes d’erre qui s’inscrivent à l’encre de Chine sur une carte, lignes hachées, saccadées le plus souvent, comme les trajets sans fin de ces errants ? Lignes d’erre « où les stations, retours, balancements et boucles obéissent à des invites à la fois réelles et imaginaires, décodées, ouvertes en constellation et non clôturées en système ».
La portée de cette entreprise cartographique, on le voit et plus encore le pressent, est immense. Par le tracé et le transcrit, Deligny et ses compagnons espèrent se frayer un chemin et déchirer cette taie qu’est le langage : mettre à jour un réseau de présences sans pour autant dresser un cadastre, ni figer des relations, ni chercher à capter une indiscernable identité ; mais montrer comment des repères ont joué, et ont permis à l’enfant de s’insérer dans le cours des choses plus que dans l’ordre symbolique. »Les cartes ne sont pas des instruments d’observation. Ce sont des instruments d’évacuation : évacuation du langage, mais aussi évacuation de l’angoisse thérapeutique ». Ce que nous apprennent aussi les cartes, c’est que pour l’enfant mutique, le monde devient angoissant dès qu’il cesse d’être immuable : mais comment distinguer l’immuable de ce qui est mort, devenu étranger au temps ? certains diraient aussi devenu éternel… seul le réitéré du coutumier peut ainsi offrir des repères qui sont autant d’ancrages dans le réel. Deligny met cependant en garde contre ce que révèlent des cartes trop aisément satisfaisantes, à travers lesquelles on finit par croire que l’enfant est « quelqu’un » ; celles où la ligne d’erre du gamin psychotique, et les fleurs noires, se superposent exactement aux trajets de l’adulte. Là naît le routinier, là gisent les choses mortes peu à peu substituées aux « repères vifs ».
Tous ces « gestes à l’infinitif » tiennent aussi du rituel, et Deligny n’hésite pas à affirmer que « l’Église a une racine dans le monde autistique… Les rituels quels qu’ils soient et les rituels religieux en particulier, tendent à épaissir les gestes quotidiens pour leur donner une apparence de choses, ils en font des pierres » . Qu’on ne s’y trompe pas : pour ces curieux navigateurs des Cévennes la vérité est dans les pierres au moins autant que dans les mots…
De même, tracer une carte n’est-il pas toujours un acte politique ? Certes, nous sommes loin ici de ce tracé vainqueur par quoi les grands conquérants établirent l’étendue de leur pouvoir et assirent leur domination sur les hommes à travers leur maîtrise des lointains espaces. Mais toute exploration de l’inconnu et tout quadrillage d’un territoire tend à faire diminuer l’angoisse humaine, et celle de ces enfants-là plus que de tous autres. Ce qu’espère Deligny c’est que sa cartographie prouvera, par la découverte de ce corps commun présent aux lieux-chevêtres, qu’il est possible de se comporter autrement « qu’en ruminant ou en dominant ». Une réelle communauté (qu’on se souvienne de ce commun qui est comme un) ne peut émerger qu’en ces lieux, à mi-chemin des choses et de l’ordre symbolique qui menace sans cesse de reconstruire son pouvoir.
Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de ce que le fondement possible d’une démocratie réelle n’apparaisse qu’entre des enfants jugés incurables et des adultes ayant quasiment renoncé à tout ce que la civilisation actuelle considère comme ses acquis fondamentaux ? C’est sans doute là le prix qu’il faut payer pour recouvrer l’innocence.
Archéologie patiente et obstinée, silencieuse et coutumière, non d’un savoir mais d’un « faire » ; qui ne met pas à jour un sens par quoi se révèlerait la présence d’un ordre symbolique oublié ou caché, sans doute pour toujours étranger à ces enfants, mais le « fil des choses », grâce auquel l’enfant mutique peut entrer parfois en vibration avec le monde, saisi par certaines de ces harmonies « vieilles comme l’humain » ; en effet « le corps commun » n’est pas un cadastre, mais « un ensemble de moments où l’émoi n’est pas pour rien ».
Il ne s’agit pas ici de rééduquer (Deligny voit se profiler tous les colonialismes derrière ce seul mot), ni de soigner (certains lui reprocheront d’ailleurs d’enfermer définitivement les enfants dans leur psychose), mais d’entreprendre avec eux une dérive, qui est tout à la fois errance au gré des choses plus que des affects, et aussi « presque rien, un bout de bâton planté dans l’océan », c’est-à-dire presque tout pour ces enfants privés des repères les plus élémentaires, à commencer par celui d’un Moi structuré. En état d’apesanteur créé par l’absence de langage et donc de fin (tout à la fois but et terme d’une entreprise humaine), on vit ici comme « à perte de vue », dans la réitération quasi rituelle du quotidien. « Erre : le mot m’est venu. Il parle un peu de tout, comme tous les mots. Il y va d’une « manière d’avancer, de marcher » dit le dictionnaire, de la « vitesse acquise d’un bâtiment sur lequel n’agit plus le propulseur » et aussi des « traces d’un animal ». Mot fort riche, comme on le voit, qui parle de marche, de mer et d’animal et qui recèle bien d’autres échos : « errer : s’écarter de la vérité … aller de côté et d’autre, au hasard, à l’aventure ». J.-J Rousseau le dit : « voyager pour voyager c’est errer, être vagabond ». C’est aussi « se manifester ça et là, et fugitivement, sur divers objets, sourire aux lèvres ». » Mot-coquillage, dira encore Deligny, ramassé sur quelque plage de sa mémoire, tout rempli de sable…. En errant l’enfant réitère certains gestes qui, fondus dans le coutumier des adultes, l’ornent et tracent ainsi des repères.
Mais puisque l’enfant psychotique n’a pas de Moi constitué, n’est donc pas un Je sujet, face à d’Autres sujets, on ne saurait le faire évoluer par la seule reconnaissance de ce manque absolu. Deligny quant à lui refuse ce rôle de « nanti » (du langage, de la pensée…) face aux enfants irrémédiablement déficitaires ; il s’interroge plutôt sur ce qui peut bien leur manquer, à lui et à ses compagnons, pour être à ce point inexistants aux yeux de ces enfants-là. Et c’est là que la carte va jouer son rôle essentiel. La « personne » ne peut plus être désignée par ce qu’elle est (nom, personnalité, aptitudes intellectuelles réduits à néant par la psychose), mais par ce qui « a lieu » à travers Elle. Nous assistons alors à l’étonnante substitution d’une topographie et topologie à l’habituelle et ici inopérante psychologie. Encore faut-il préciser que ce qui intéresse Deligny n’est pas d’étudier comment l’enfant structure son espace vital, et par cela même développe son intelligence (point de vue applicable seulement à des enfants dont l’intelligence sensori-motrice prépare les opérations abstraites et logiques), mais plutôt comment ces « drôles d’animaux vagabonds », ces exilés, ces errants, définissent sans le savoir et le vouloir le territoire d’un « faire » qui, réitéré, orné, les mettra en relation avec les Autres par l’intermédiaire des choses.
D’où ces jeux de mots, fréquents chez Deligny, qui marquent ce nécessaire glissement de la psychologie à la topologie :
celui-là devient ce lui là
(la désignation d’une personne constituée est remplacée par la simple désignation d’une certaine réalité tombant sous un regard, occupant une certaine portion d’espace, effectuant certains gestes…)
De même « il arrive » ne devrait-il pas plutôt être écrit il a rive ? tandis que « il » serait transcrit île ? Et chacun n’est-il pas originairement chaque un ? et commun, comme un ?
Que sont-ils en effet ces enfants-là, sinon les lignes d’erre qui s’inscrivent à l’encre de Chine sur une carte, lignes hachées, saccadées le plus souvent, comme les trajets sans fin de ces errants ? Lignes d’erre « où les stations, retours, balancements et boucles obéissent à des invites à la fois réelles et imaginaires, décodées, ouvertes en constellation et non clôturées en système ».
La portée de cette entreprise cartographique, on le voit et plus encore le pressent, est immense. Par le tracé et le transcrit, Deligny et ses compagnons espèrent se frayer un chemin et déchirer cette taie qu’est le langage : mettre à jour un réseau de présences sans pour autant dresser un cadastre, ni figer des relations, ni chercher à capter une indiscernable identité ; mais montrer comment des repères ont joué, et ont permis à l’enfant de s’insérer dans le cours des choses plus que dans l’ordre symbolique. »Les cartes ne sont pas des instruments d’observation. Ce sont des instruments d’évacuation : évacuation du langage, mais aussi évacuation de l’angoisse thérapeutique ». Ce que nous apprennent aussi les cartes, c’est que pour l’enfant mutique, le monde devient angoissant dès qu’il cesse d’être immuable : mais comment distinguer l’immuable de ce qui est mort, devenu étranger au temps ? certains diraient aussi devenu éternel… seul le réitéré du coutumier peut ainsi offrir des repères qui sont autant d’ancrages dans le réel. Deligny met cependant en garde contre ce que révèlent des cartes trop aisément satisfaisantes, à travers lesquelles on finit par croire que l’enfant est « quelqu’un » ; celles où la ligne d’erre du gamin psychotique, et les fleurs noires, se superposent exactement aux trajets de l’adulte. Là naît le routinier, là gisent les choses mortes peu à peu substituées aux « repères vifs ».
Tous ces « gestes à l’infinitif » tiennent aussi du rituel, et Deligny n’hésite pas à affirmer que « l’Église a une racine dans le monde autistique… Les rituels quels qu’ils soient et les rituels religieux en particulier, tendent à épaissir les gestes quotidiens pour leur donner une apparence de choses, ils en font des pierres » . Qu’on ne s’y trompe pas : pour ces curieux navigateurs des Cévennes la vérité est dans les pierres au moins autant que dans les mots…
De même, tracer une carte n’est-il pas toujours un acte politique ? Certes, nous sommes loin ici de ce tracé vainqueur par quoi les grands conquérants établirent l’étendue de leur pouvoir et assirent leur domination sur les hommes à travers leur maîtrise des lointains espaces. Mais toute exploration de l’inconnu et tout quadrillage d’un territoire tend à faire diminuer l’angoisse humaine, et celle de ces enfants-là plus que de tous autres. Ce qu’espère Deligny c’est que sa cartographie prouvera, par la découverte de ce corps commun présent aux lieux-chevêtres, qu’il est possible de se comporter autrement « qu’en ruminant ou en dominant ». Une réelle communauté (qu’on se souvienne de ce commun qui est comme un) ne peut émerger qu’en ces lieux, à mi-chemin des choses et de l’ordre symbolique qui menace sans cesse de reconstruire son pouvoir.
Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de ce que le fondement possible d’une démocratie réelle n’apparaisse qu’entre des enfants jugés incurables et des adultes ayant quasiment renoncé à tout ce que la civilisation actuelle considère comme ses acquis fondamentaux ? C’est sans doute là le prix qu’il faut payer pour recouvrer l’innocence.
* Toutes les citations entre guillemets doivent être attribuées à Deligny ou à ses compagnons de dérive et sont extraites des Cahiers de l’immuable (Volumes 1- 2-3) – Revue Recherches N° 18-20 et 24 publiés par le CERFI.
Documents accompagnant la publication du texte :