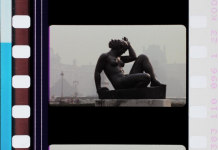Les livres, le père les trouvait dans les trains de banlieue. Il les trouvait aussi séparés des poubelles, comme offerts, après les décès ou les déménagements. Une fois il avait trouvé la Vie de Georges Pompidou. Par deux fois il avait lu ce livre-là. Il y avait aussi des vieilles publications techniques ficelées en paquets près des poubelles ordinaires mais ça, il laissait. La mère aussi avait lu la Vie de Georges Pompidou. Cette Vie les avait également passionnés. Après celle-là ils avaient recherché des Vies de Gens célèbres – c’était le nom des collections – mais ils n’en avaient plus jamais trouvé d’aussi intéressante que celle de Georges Pompidou, du fait peut-être que le nom de ces gens en question leur était inconnu. Ils en avaient volé dans les rayons « Occasions » devant les librairies. C’était si peu cher les Vies que les libraires laissaient faire.Le père et la mère avaient préféré le récit du déroulement de l’existence de Georges Pompidou à tous les romans. Ce n’était pas seulement en raison de sa célébrité que les parents s’étaient intéressés à cet homme-là, c’était au contraire à partir de la logique commune à toutes les vies que les auteurs de ce livre avaient raconté celle de Georges Pompidou, si éminent que cet homme ait été. Le père se retrouvait dans la vie de Georges Pompidou et la mère dans celle de sa femme. C’étaient des existences qui ne leur étaient pas étrangères et qui même n’étaient pas sans rapports avec la leur.
Sauf les enfants, disait la mère.
C’est vrai, disait le père, sauf les enfants.
C’était dans le récit de l’occupation du temps de la vie qu’ils trouvaient l’intérêt de la lecture des biographies et non dans celui des accidents singuliers qui en faisaient des destinées privilégiées ou calamiteuses. D’ailleurs, à vrai dire, même ces destinées-là, parfois, elles ressemblaient les unes aux autres. Avant ce livre, le père et la mère ne savaient pas à quel point leur existence ressemblait à d’autres existences.
Toutes les vies étaient pareilles disait la mère, sauf les enfants. Les enfants, on ne savait rien.
C’est vrai, disait le père, les enfants on sait rien.
Une fois qu’ils avaient commencé un livre, les parents le finissaient toujours, même s’il s’avérait très vite être ennuyeux et si sa lecture leur prenait des mois. Ainsi en était-il du livre d’Edouard Herriot, La Forêt Normande, qui ne parlait de personne, mais seulement du début jusqu’à la fin de la forêt normande.
Les parents, c’étaient des étrangers qui étaient arrivés à Vitry, depuis près de vingt ans, plus de vingt ans peut-être. lis s’étaient connus là, mariés là, à Vitry. De cartes de séjour en cartes de séjour, ils étaient encore là à titre provisoire. Depuis, oui, très longtemps. Ils étaient des chômeurs, ces gens. Personne n’avait jamais voulu les employer, parce qu’ils connaissaient mal leurs propres origines et qu’ils n’avaient pas de spécialité. Eux, ils n’avaient jamais insisté. C’est à Vitry aussi que leurs enfants étaient nés, y compris l’aîné qui était mort. Grâce à ces enfants ils avaient été logés. Dès le deuxième on leur avait attribué une maison dont on avait arrêté la destruction, en attendant de les loger dans un H.L.M. Mais ce H.L.M. n’avait jamais été construit et ils étaient restés dans cette maison, deux pièces, chambre et cuisine, jusqu’à ce que un enfant arrivant chaque année la commune ait fait construire un dortoir en matériau léger séparé de la cuisine par un couloir. Dans ce couloir dormaient Jeanne et Ernesto, les aînés des sept enfants. Dans le dortoir les cinq autres. Le Secours Catholique avait fait don de poêles à mazout en bon état.
Le problème de la scolarisation des enfants ne s’était jamais sérieusement posé ni aux employés de la mairie ni aux enfants ni aux parents. Une fois ceux-ci avaient bien demandé qu’un instituteur se déplace jusqu’à eux pour enseigner à leurs enfants mais on avait dit quelle prétention et puis quoi encore. Voilà, ça s’était passé comme ça. Dans tous les rapports de la mairie les concernant il était fait état de la mauvaise volonté de ces gens et de l’obstination étrange qu’ils mettaient à s’y tenir.
Ces gens lisaient donc des livres qu’ils trouvaient soit dans les trains soit aux étals des librairies d’occasion, soit près des poubelles. Ils avaient bien demandé d’avoir accès à la bibliothèque municipale de Vitry. Mais on avait dit il ne manquerait plus que ça. Ils n’avaient pas insisté. Heureusement il y avait eu les trains de banlieue où trouver des livres et les poubelles. Le père et la mère avaient des cartes de transport gratuit à cause de leurs nombreux enfants et ils allaient souvent à Paris aller et retour. Ça, c’était surtout depuis cette lecture sur Georges Pompidou qui les avait tenus pendant un an.
Une fois il y avait eu une autre histoire de livre dans cette famille. Celle-là était arrivée chez les enfants au début du printemps.
A ce moment-là Ernesto devait avoir entre douze ans et vingt ans. De même qu’il ne savait pas lire, de même Ernesto ne savait pas son âge. Il savait seulement son nom.
La chose était arrivée dans le sous-sol d’une maison voisine, une sorte d’appentis que les gens laissaient toujours ouvert pour ces enfants-là et où ceux-ci allaient se réfugier chaque jour après le coucher du soleil ou dans l’après-midi lorsqu’il faisait froid ou qu’il pleuvait, en attendant le dîner. C’était dans cet appentis, dans une galerie par où passaient des tuyaux de chauffage central, sous des gravats, que les plus petits des brothers avaient trouvé le livre. Ils l’avaient rapporté à Ernesto qui l’avait longuement regardé. C’était un livre très épais recouvert de cuir noir dont une partie avait été brûlée de part et d’autre de son épaisseur par on ne savait pas quel engin mais qui devait être d’une puissance terrifiante, genre chalumeau ou barre de fer rougie au feu. Le trou de la brûlure était parfaitement rond. Autour de lui le livre était resté comme avant d’être brûlé et on aurait dû arriver à lire cette partie des pages qui l’entourait. Les enfants avaient déjà vu des livres aux devantures des librairies et chez leurs parents mais ils n’avaient jamais vu de livre aussi cruellement traité que celui-ci. Les très jeunes brothers et sisters avaient pleuré.
Dans les jours qui avaient suivi la découverte du livre brûlé Ernesto était entré dans une phase de silence. Il était resté des après-midi entiers dans l’appentis, enfermé avec le livre brûlé.
Puis brusquement Ernesto avait dû se souvenir de l’arbre.
Il s’agissait d’un jardin qui se trouvait à l’angle de la rue Berlioz et d’une rue presque toujours déserte, la rue Camélinat, qui descendait en pente très raide jusqu’à la fosse de l’autoroute et le Port-à-l’Anglais de Vitry. Ce jardin était entouré d’une clôture grillagée étayée par des piquets de fer, tout ça très bien fait, aussi bien qu’on avait fait autour des autres jardins de la rue qui étaient à peu près de la même superficie que celui-ci et de la même forme.
Mais dans ce jardin-là il n’y avait aucune diversité, aucune plate-bande, aucune fleur, aucune plante, aucun massif. Il y avait seulement un arbre. Un seul. Le jardin c’était ça, cet arbre.
Les enfants n’avaient jamais vu d’autres arbres de cette espèce. A Vitry c’était le seul et peut-être même en France. Il aurait pu paraître ordinaire, on aurait pu ne pas le remarquer. Mais une fois qu’on l’avait vu il ne pouvait plus sortir de l’esprit. Sa taille était moyenne. Son tronc, aussi droit qu’un trait sur une page nue. Son feuillage en dôme aussi dense et beau qu’une belle chevelure au sortir de l’eau. Mais sous ce feuillage le jardin était un désert. Rien n’y poussait faute de lumière.
Cet arbre était sans âge, indifférent aux saisons, aux latitudes, dans une solitude sans recours. Sans doute n’était-il plus nommé dans les livres de ce pays ici. Peut-être ne l’était-il plus nulle part.
Plusieurs jours après la découverte du livre, Ernesto était allé voir l’arbre et il était resté auprès de lui, assis sur le talus opposé au grillage qui l’entourait. Ensuite, chaque jour il y était allé. Quelquefois il y restait longtemps, mais de même toujours seul. Il ne parlait jamais à personne, sauf à Jeanne, de ses visites à l’arbre. C’était le seul lieu, curieusement, où les brothers et les sisters ne venaient pas retrouver Ernesto.
L’arbre, après le livre brûlé, c’était peut-être ce qui avait commencé à le rendre fou. C’est ce que pensaient les brothers et les sisters. Mais fou comment, ils pensaient que jamais ils ne le sauraient.
Un soir, les brothers et les sisters avaient demandé à Jeanne ce qu’elle en pensait, si elle avait une idée. Elle, elle pensait qu’Ernesto avait dû être frappé par la solitude de l’arbre et par celle du livre. Elle, elle croyait qu’Ernesto avait dû rassembler le martyr du livre et celui de la solitude de l’arbre dans une même destinée. Ernesto lui avait dit que c’était lorsqu’il avait découvert le livre brûlé qu’il s’était souvenu de l’arbre enfermé. Il avait pensé aux deux choses ensemble, à comment faire leur sort se toucher, se fondre et s’emmêler dans sa tête et dans son corps à lui, Ernesto, jusqu’à celui-ci aborder dans l’inconnu du tout de la vie.
Jeanne avait ajouté : Et à moi aussi il avait pensé Ernesto.
Mais les brothers et les sisters n’avaient rien compris à ce qu’avait dit Jeanne et ils s’étaient endormis. Jeanne ne s’en était pas aperçue et elle avait continué à parler de l’arbre et d’Ernesto.
Extrait des sept premières pages du livre « La pluie d’été », initialement publié sur le site des éditions P.O.L
Ce texte à été écrit dans le souvenir du tournage du film « Les Enfants », édité en dvd chez Benoît Jacob.